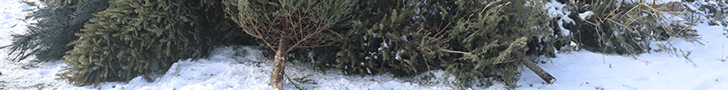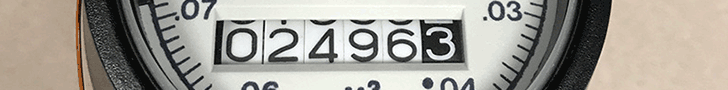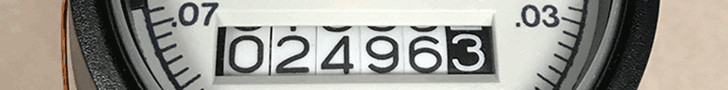Pourquoi parle-t-on de revitalisation des langues? Discussion avec Barbara Nolan et Dre Lindsay Morcom sur l’histoire de la perte des langues autochtones et sur la façon dont les groupes autochtones se battent aujourd’hui pour réclamer et reconstruire ce qui leur a été volé.
Barbara Nolan a grandi sur l’île Manitoulin, du côté sud de la Première Nation Wiikwemkoong. Dans son enfance, elle se souvient de l’omniprésence de l’anishinaabemowin.
« Tout le monde parlait la langue. Nous n’avions pas les interférences de la radio, de la télévision. Nous n’avions pas d’interférence d’aucune autre sorte de langue. »
Mais à l’âge de cinq ans, parce que sa famille vivait loin de la ville, elle et sa sœur ont été envoyées dans un pensionnat à Spanish, en Ontario.
« Dans les pensionnats, leur mission était de nous débarrasser de notre langue et de nous donner la langue anglaise, et ils l’ont fait d’une manière très sévère, explique-t-elle à une salle remplie d’élèves Anishinaabe à l’école primaire East View de Sault-Sainte-Marie en 2016.
« On commençait à parler notre langue, en disant Où est mon papa? dans notre langue, parce que nous ne connaissions pas l’anglais, rappelez-vous. Et tout de suite, on nous donnait un coup de sangle. »
Tout au long de l’histoire, les colonisateurs et les institutions canadiennes ont utilisé diverses approches pour empêcher les peuples autochtones d’accéder à leur langue.
Dans les externats et les pensionnats fédéraux pour Autochtones, les enfants n’avaient pas le droit d’utiliser leur langue, étaient forcés à parler anglais ou français, et subissaient des pressions pour s’assimiler à la société occidentale et abandonner leur héritage autochtone.
La punition était l’outil le plus utilisé pour empêcher les enfants autochtones d’accéder à leur langue.
Les enfants étaient soumis à des châtiments corporels pour avoir parlé leur langue maternelle jusqu’à ce qu’ils apprennent et intègrent pleinement l’anglais ou le français, semant honte et peur chez les jeunes autochtones pour qu’ils freinent le plus possible la connaissance de leur langue.
« Il s’agissait d’un génocide culturel visant à priver les enfants autochtones de leur identité, de leur langue et de leur culture », dit Lindsay Morcom, professeure, doyenne associée des études supérieures à l’Université Queen’s et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la revitalisation linguistique et la décolonisation de l’éducation.
Le rôle des langues dans la culture
Lindsay Morcom souligne l’importance de la langue comme pierre angulaire du partage de la culture.
Elle est non seulement un élément crucial pour la diffusion d’un patrimoine commun, mais elle confère aussi des idées, des concepts et des perspectives qui ne peuvent parfois pas être traduits.
« Un langage, c’est tout, dit-elle. Les langues autochtones sont très différentes des langues occidentales. Il existe des modes de pensée, des systèmes de connaissance, des traditions intellectuelles qui ne peuvent être traduits dans les langues coloniales. »
La revitalisation, une force de décolonisation
« J’étais liée et déterminée, dit Barbara Nolan, qui a été nommée Commissaire aux langues de la Nation Anishinabek en 2020. Je me suis dit : Je vais garder ma langue. Je ne me souciais pas de l’horreur de la punition, tant que je gardais ma langue. »
Lindsay Morcom exprime sa profonde reconnaissance envers les locuteurs et locutrices natifs qui continuent à parler et à diffuser leur langue. Par leur détermination, ils ont assuré sa survie.
En effet, les punitions infligées étaient si répandues que, dans certaines langues, il ne restait plus qu’une seule personne qui parlait couramment la langue.
Cependant, les efforts de revitalisation des langues déployés dans tout le Canada, avec l’aide de ces individus, ont permis de partager leurs connaissances et de sauver plusieurs langues autochtones.
« Certaines communautés ont revitalisé leurs langues en s’appuyant sur des documents historiques, explique Dre Morcom. Il nous incombe de faire le nécessaire pour ne pas faire notre deuil de ces langues, mais plutôt assurer leur survie à travers le temps. »
En tant que l’une de ces survivantes, qui a ensuite créé le premier programme d’enseignement des langues autochtones au Canada et qui a consacré sa vie à la diffusion de l’anishinaabemowin par l’éducation de personnes de tous âges et la création de contenus éducatifs pour les programmes d’immersion, Barbara Nolan reconnaît qu’il est important de se tourner vers l’avenir.
« Je ne m’attarde pas sur le passé. Nous n’allons pas rester coincés là », dit-elle.
Plusieurs approches à la revitalisation
Idéalement, la revitalisation de la langue serait une approche à plusieurs volets, en commençant par la transmission des connaissances par l’éducation.
Par exemple, l’école d’immersion Mnidoo Mnising Anishinabek Kinoomaage Gaming (MMAK), sur l’île Manitoulin, a réussi à enseigner l’anishinaabemowin à des enfants qui ne parlaient pas la langue en seulement quelques années.
À grande échelle, la création de programmes d’immersion pour les enfants impliquerait la formation de locuteur.trice.s fluides pour enseigner les matières scolaires générales, afin qu’ils et elles transmettent efficacement la langue dans toutes les facettes de l’apprentissage des enfants.
« Comment peut-on produire des locuteurs quand ils n’ont que 20 minutes par jour dans leur langue cible? demande Barbara Nolan. Il faut enseigner les mathématiques, la géographie et les sciences dans la langue. C’est difficile, mais c’est possible. Les francophones l’ont fait, alors nous allons le faire. »
Mais l’apprentissage peut aussi se faire en dehors des écoles, par exemple dans le cadre des programmes proposés par les centres d’amitié.
« Ce que nous voulons avant tout, c’est que la langue soit introduite dans tous les aspects de la vie autochtone, de sorte que l’on puisse la parler à l’épicerie, avec ses enfants, et l’utiliser sur le lieu de travail. »
L’enseignement des langues autochtones aux allochtones peut également, selon Dre Morcom, s’inscrire dans le cadre des efforts de revitalisation linguistique.
Bien que les points de vue divergent à ce sujet, elle estime que l’apprentissage, même rudimentaire, d’une langue autochtone peut donner aux allochtones un aperçu de la richesse des cultures autochtones, à condition que ceux-ci « reconnaissent que la langue n’est pas la leur ».
Dans le cadre de ses recherches, Lindsay Morcom a constaté que l’introduction d’une langue autochtone dans les écoles publiques avait des effets positifs sur tous les élèves et le personnel, même s’ils étaient allochtones.
Les élèves et les enseignant.e.s autochtones se sentaient plus proches de leurs ancêtres et de leur langue et en ressortaient plus fiers.
Chez les élèves allochtones, l’exposition positive au savoir autochtone en faisait des allié.e.s plus probables et réduisait le risque de racisme contre les peuples autochtones.
La revitalisation au quotidien
Dans un véritable esprit de réconciliation et de réparation pour la disparition forcée des langues autochtones, Lindsay Morcom estime que l’idéal serait que l’accès à ces langues soit généralisé.
Tout comme les universités ont des majeures de langue anglaise ou française, elle souhaite qu’il y ait des majeures en langues autochtones.
Au quotidien, la signalisation publique, qu’il s’agisse d’affiches dans des musées ou de panneaux routiers, devrait comporter des langues autochtones.
« J’aimerais voir les langues partout, dit-elle. Je veux que chaque personne autochtone au Canada ait accès à sa langue et à sa culture grâce à des possibilités d’apprentissage de la langue qui lui conviennent. Je veux voir un statut linguistique national. »
Cet article est issu de notre édition spéciale vérité et réconciliation, consacrée aux langues autochtones.
Initiative de journalisme local – Réseau.Presse – La Liberté