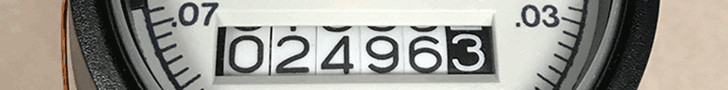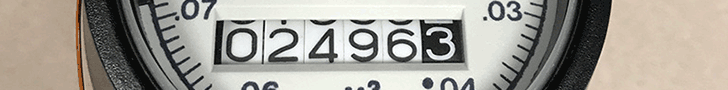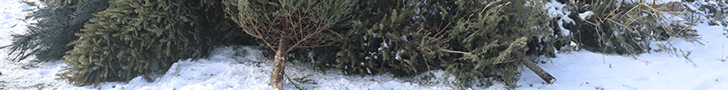À l’occasion de SORTIR DU CADRE, le Collectif LGBTQ* du Manitoba présente un troisième atelier en ligne qui abordera la thématique de la sobriété au sein des espaces et mouvements queers.
Ce 26 novembre aura lieu la troisième séance de SORTIR DU CADRE, un projet du Collectif LGBTQ* du Manitoba en collaboration avec le Comité Francoqueer de l’Ouest. Cette séance aura lieu à 18 h 30 en ligne et sera animée par Maxe Giguère, associé·e de recherche au Collectif LGBTQ*.
Le but de cette séance intitulée, Mon edge est tout sauf straight : explorer la sobriété queer, est de discuter de la sobriété de façon à l’aborder comme un outil dans les luttes queer.
À partir du zine du même nom, Mon edge est tout sauf straight, Maxe Giguère souhaite « expliquer pourquoi la sobriété peut être un choix politique et identitaire pour les personnes queer ».
Un zine
Les zines sont des petites publications, généralement il s’agit de « petits documents minuscules », explique Maxe Giguère.
Celui qui inspire cet atelier est disponible gratuitement en ligne, comme iel ajoute « il a été publié en 2014 et traduit en français en 2017 ».
Maxe Giguère a d’abord été introduit·e à l’ouvrage grâce à des amis.
Ainsi, le zine Mon edge est tout sauf straight a été pensé et écrit pour réfléchir sur la sobriété, mais aussi connaître l’histoire de ce mouvement dans les luttes queer. Le titre de la séance, mélange d’anglais et de français, reflète une réalité linguistique au sein de la francophonie queer.
Comme iel explique : « Beaucoup de mots dans ce domaine-là n’ont pas vraiment de traduction française, à la fois uniforme et acceptée. Ça reste une difficulté, quand on est dans des groupes plus minoritaires, d’avoir des mots qui décrivent bien la réalité sans toujours prendre des mots anglais ».
Choix politique
Ici, lorsque l’on évoque la sobriété, il n’est pas forcément question de substances pouvant altérer l’état de conscience, mais de rapport au corps et à l’addiction.
Comme Maxe Giguère le précise, il est possible d’avoir un rapport d’addiction avec le sucre, le tabac ou le café par exemple. Contrôler son corps, c’est aussi contrôler son esprit, et donc être plus apte à être engagé politiquement.
Des techniques qui se sont répandues à travers les époques au sein de divers mouvements de lutte : « Il y avait cette idée-là, raconte Maxe Giguère, de se dire que si l’on refuse de consommer des substances, on va être plus en forme pour militer contre les injustices ».
Santé publique
Selon Statistique Canada, en 2023, 77 % des adultes canadiens déclaraient avoir consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois, contre 76 % en 2013 et 78 % en 2012.
Chez les plus jeunes, les chiffres de la consommation d’alcool sont en baisse.
D’après l’Enquête canadienne sur l’alcool et les drogues chez les élèves (ECADE), 52,7 % des élèves de la 7e à la 12e année affirmaient avoir déjà consommé de l’alcool en 2016-2017, contre 45,9 % en 2023-2024.
Sur la même période, la proportion de jeunes ayant une consommation à haut risque diminue également, passant de 24,2 % à 20,6 %.
Pour Maxe Giguère, cette baisse témoigne de transformations sociales profondes, car « la sobriété est davantage acceptée au Canada », explique-t-iel, qui y voit le reflet de nouvelles habitudes et valeurs collectives.
Mais pour Maxe Giguère, ces changements peuvent aussi être perçus à travers le prisme des conditions sociales actuelles.
À la fois l’inflation, la difficulté à se loger, et à se nourrir sont à considérer quand « les personnes doivent couper dans leurs dépenses, ça se fait souvent du côté de la consommation et des loisirs », ajoute l’associé·e de recherche.
Cependant, même d’un point de vue de santé publique, des inégalités persistent.
« On lit souvent dans les statistiques que les personnes LGBTQ ont plus de risques d’avoir des problèmes d’addiction ou de consommation », souligne Maxe Giguère.
En effet, selon les données relayées par le Partenariat canadien contre le cancer, près de 25 % des membres de la communauté LGBTQ2S+ déclarent des modes de consommation jugés problématiques.
Par ailleurs, les femmes lesbiennes et bisexuelles seraient 1,6 fois plus susceptibles que les femmes hétérosexuelles de signaler une consommation élevée d’alcool.
De plus, une personne LGBTQ2S+ sur quatre affirmerait consommer de l’alcool ou des drogues pour chercher à surmonter des abus émotionnels et/ou physiques.
Outil d’inclusion
Maxe Giguère nous parle de la théorie de la contagion sociale.
Ce phénomène permet de comprendre comment certains comportements se diffusent au sein d’un groupe.
Ainsi, iel explique : « Quand tu as un certain comportement, tu influences les autres autour de toi à l’adopter. C’est pour ça que, dans une famille où quelqu’un fait du sport, les autres ont plus de chances d’en faire aussi ».
C’est cette dynamique que l’atelier souhaite reproduire à travers des discussions autour de la sobriété, mais pour que cette contagion soit effective, encore faut-il des espaces d’échanges inclusifs.
« J’ai vu des personnes avec de gros problèmes de consommation devenir sobres, raconte-t-iel, et ça a changé leur vie. J’ai un parcours similaire. C’est une contagion par l’exemple, et c’est pour ça que c’est important. »
À la croisée d’une quête de lieux sobres et inclusifs, iel insiste sur la nécessité d’avoir les deux, autant pour « les personnes queer sobres, que celles qui sont plus jeunes et veulent rencontrer des gens qui leur ressemblent sans que la consommation soit au centre », indique Maxe Giguère.
Les espaces ou collectifs n’ont pas nécessairement à être catégorisés comme étant sobres, mais les activités peuvent l’être.
Réflexion collective
Pour Maxe Giguère, la consommation ne peut être comprise sans tenir compte des oppressions systémiques subies : « Ce n’est pas nécessairement la faute des individus. Quand tu subis des oppressions économiques, en matière de logement, au travail ou dans le système de santé, la consommation devient un mécanisme de défense. Tant qu’on vit dans une société oppressive, il y aura des formes de défense comme la consommation. »
C’est justement pour cette raison que, pour iel, la sobriété queer prend tout son sens.
En ce sens, l’atelier du 26 novembre s’appuiera donc sur des expériences à la fois personnelles et collectives, nourries par des savoirs communautaires comme le zine, mais aussi scientifiques.
Néanmoins, l’objectif n’est pas de transmettre de l’information de façon magistrale mais « d’ouvrir des discussions philosophiques autour des valeurs, de la santé collective et de nos rapports à la sobriété » indique-t-iel.
« Il s’agit d’avoir un espace pour réfléchir autrement à la consommation, à la sobriété, et surtout de proposer un discours alternatif à celui de la santé publique, qui dit souvent que les personnes LGBTQ consomment plus. Réfléchir à la sobriété non pas à travers nos problèmes, mais comme une voie de réflexion et d’émancipation, et c’est ça qui est intéressant », conclut Maxe Giguère.