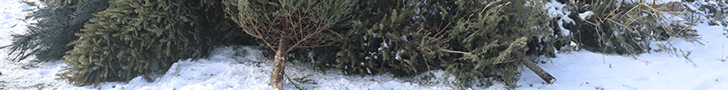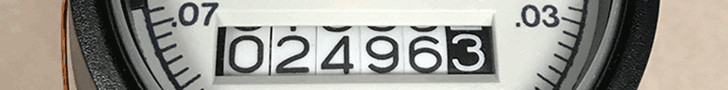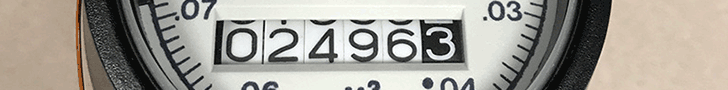Par Camille LANGLADE, Julien CAYOUETTE et Inès LOMBARDO.
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation publiait un rapport avec 94 appels à l’action pour faire avancer la réconciliation au Canada. Mais selon plusieurs observateurs, peu de progrès ont été réalisés en une décennie.
Après avoir passé six mois à parcourir le Canada et entendu plus de 6 500 témoignages, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) déposait son rapport final, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir.
Ses appels à l’action s’articulaient autour de six grands thèmes : la protection de l’enfance, l’éducation, la langue et la culture, la santé et la justice, et la réconciliation.
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – officiellement instituée comme jour férié le 30 septembre 2021 – découle d’un des appels à l’action de la CVR et vise à rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leur famille et leur communauté.
La CVR recommandait notamment à tous les gouvernements d’adopter des mesures pour garantir la sécurité des enfants autochtones, ainsi que d’élaborer des programmes d’éducation adaptés à la culture des familles autochtones.
Elle insistait aussi sur la nécessité de protéger et de revitaliser les langues autochtones au moyen d’une législation dédiée et de fonds suffisants, et de lutter contre le racisme systémique.
Jusqu’à maintenant, seulement 14 recommandations ont été mises en œuvre rapporte l’organisme à but non lucratif Indigenous Watchdog; 45 % sont en cours de réalisation, 23 % ont été bloquées et 17 % sont encore au point mort.
« Cela signifie que 40 % de tous ces appels à l’action sont à l’arrêt », résume l’éditeur et fondateur du site Internet Indigenous Watchdog Douglas Sinclair, membre de la Première Nation Peguis du Manitoba.
Dans un courriel à Francopresse, le ministère des Relations Couronne-Autochtones affirme plutôt que 85 % des appels à l’action ont été menés à bien ou sont en cours de réalisation.
Appels à l’action mis en œuvre jusqu’à maintenant :
– Protection de l’enfance : 0 recommandation sur 5
– Éducation : 0 recommandation sur 11
– Langue et culture : 2 recommandations sur 5
– Santé : 0 recommandation sur 7
– Justice : 1 recommandation sur 21
– Réconciliation : 11 recommandations sur 45
Source : Indigenous Watchdog
Pourquoi ce retard?
Selon Douglas Sinclair, ce statuquo s’explique principalement par un manque de volonté politique au sein des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le racisme systémique et un manque de données concernant les Autochtones.
Avec les préparatifs pour souligner le 10e anniversaire du dépôt du rapport, le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) n’était pas disponible pour une entrevue. L’organisme a toutefois pris le temps de partager avec Francopresse une courte vidéo où leur directrice de la sensibilisation, Kaila Johnston, énumère les principaux obstacles à la vérité et la réconciliation :
– une attitude paternaliste qui ne donne pas de place aux solutions apportées par les Premières Nations
– la volonté des gouvernements et des organismes gouvernementaux de préserver leur réputation
– l’absence d’un financement pour réaliser les promesses faites
– la marginalisation des Autochtones par la société canadienne
– le manque d’intérêt du public pour régler les problèmes maintenus par les législateurs et les décideurs.
Dans un article publié dans SAY Magazine le 12 septembre, le CNVR souligne aussi un manque de stratégie à long terme et de coordination du côté des instances gouvernementales.
Ce qui a été fait
Douglas Sinclair souligne toutefois quelques avancées, notamment au niveau de la santé et de la justice. « Des gouvernements investissent et mettent en place des programmes autour de la santé mentale et de la dépendance aux opioïdes. »
L’insécurité alimentaire reste cependant un problème majeur chez les Inuits. Le ministère des Relations Couronne-Autochtones affirme là encore que « les défis auxquels font face les communautés nordiques isolées sont très complexes et nécessitent une approche commune à l’échelle du gouvernement entre les territoires, les provinces, les dirigeants autochtones, les Inuits et les communautés afin de renforcer les capacités locales ».
Parmi les appels à l’action qui se sont concrétisés figure la nomination du premier commissaire aux langues autochtones, le chef Ronald E. Ignace, de la Nation Secwepemc.
Le gouvernement fédéral a également reconnu les droits des peuples autochtones, y compris leurs droits linguistiques, dans la Loi sur les langues autochtones, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
Dans l’article de SAY Magazine, le CNVR ajoute dans la liste des succès l’inclusion dans plusieurs provinces et territoires de l’histoire autochtone dans les programmes d’éducation.
Du côté judiciaire, un seul appel à l’action a été mené à terme : l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a déposé son rapport final en juin 2019. Néanmoins, sur les 231 recommandations découlant de cette Enquête, seules deux ont abouti, a déploré l’Assemblée des Premières Nations en 2024.
Dans le domaine de la protection à l’enfance, aucun appel à l’action n’a encore eu de suite concrète, mais deux sont en cours de réalisation.
En juillet dernier, l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement fédéral ont conclu une entente de 47,8 milliards de dollars pour réformer, au cours des 10 prochaines années, les programmes de protection de l’enfance.
La mise en œuvre du principe de Jordan est à l’arrêt depuis aout 2025, relève Indigenous Watchdog.
Le ministère des Relations Couronne-Autochtones renvoie la balle aux autres entités gouvernementales : « Le principe de Jordan vise à garantir aux enfants des Premières Nations un accès égal aux services de santé provinciaux, territoriaux et fédéraux existants, et ne vise pas à les remplacer. »
Ottawa a investi 8,8 milliards de dollars entre juillet 2016 et mars 2025 pour répondre à ces besoins.
Une structure par et pour les Autochtones
Pour Douglas Sinclair, l’un des chantiers les plus importants à suivre reste le Conseil national pour la réconciliation (CNR), un organisme indépendant et à but non lucratif censé surveiller, évaluer et rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des appels à l’action.
« Il a fallu 10 ans avant que, en mars dernier, le gouvernement enregistre enfin le CNR en tant qu’organisme à but non lucratif. »
Le gouvernement dispose de 18 mois pour le rendre opérationnel. « Il faudra donc attendre l’automne 2026 avant qu’il ne soit réellement en place pour agir, à condition qu’il n’y ait pas d’interruptions en cours de route. »
Douglas Sinclair espère que cette entité sera « capable d’obliger les gouvernements provinciaux et territoriaux à fournir des données qu’il sera possible de regrouper et d’analyser ».
Et la suite?
Pour Douglas Sinclair, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure le gouvernement de Mark Carney fera avancer la cause. « Au départ, il y avait beaucoup d’optimisme. On pensait qu’il allait faire des choses positives, et il en a certainement fait certaines. Il a trois Autochtones dans son cabinet, ce qui est une première dans l’histoire du Canada », amorce-t-il.
Mais il déplore « le recul sur certaines mesures climatiques qui touchent directement les territoires autochtones, les Premières Nations, les Métis et les Inuits plus que quiconque dans le pays et l’accélération de certains grands projets ».
« Le véritable test aura donc lieu lorsque [le gouvernement fédéral] sera confronté à un projet qu’il souhaite accélérer et qui suscite une opposition importante de la part des Autochtones. »