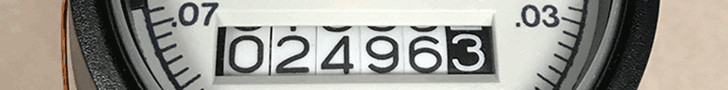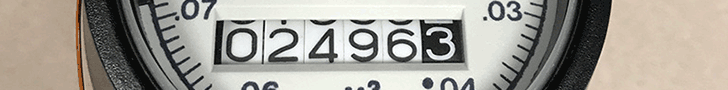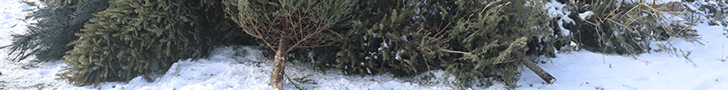Pour la chercheuse Julie Lajoie, la prévention reste mal adaptée aux réalités locales, et les campagnes de dépistage doivent changer.
À la mi-septembre, la région sanitaire de Prairie Mountain, dans l’ouest de la Province, relevait une augmentation considérable des cas de virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Sur une période de six mois seulement, les autorités de santé comptaient 75 nouveaux diagnostics.
Sur toute l’année 2024, l’on recensait alors 44 cas dans la même zone géographique.
Cette dernière couvre environ 64 800 kilomètres carrés le long de la frontière avec la Saskatchewan.
Elle inclut des centres urbains tels que Dauphin et Brandon ainsi que plusieurs Premières Nations et communautés rurales.
Constat alarmant
Si le constat est alarmant, il n’est malheureusement pas étonnant.
Lorsqu’il s’agit de maladies sexuellement transmissibles, et en particulier du VIH, le Manitoba et la Saskatchewan ont la réputation d’être de mauvais élèves.
Dans le dernier rapport de surveillance de Statistique Canada, qui date de 2023 et couvre l’année 2022, les taux les plus élevés de diagnostics de VIH étaient en Saskatchewan et au Manitoba.
Respectivement, 19,4 pour 100 000 et 13,9 pour 100 000.
Au pays, 1 833 nouveaux cas étaient déclarés, soit une augmentation de 24,9 % par rapport à 2021.
Selon Julie Lajoie, chercheuse et professeure adjointe au département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses de l’Université du Manitoba, ce que l’on a pu observer du côté de Prairie Mountain ne se cantonne pas à cette région seulement.
« On l’observe à travers le Manitoba. Il faudra attendre les chiffres, mais l’année passée, on a estimé qu’il y avait probablement eu plus d’infections que dans les années 1980 au pic de l’épidémie de VIH. Nous faisons pâle figure lorsqu’il s’agit de protection. »
Et ce malgré l’existence de moyens de prévention comme le PrEP, un médicament prescriptible qui protège les personnes non infectées lorsqu’elles sont exposées au virus de l’immunodéficience humaine.
Le cas manitobain
Un moyen de protection encore « trop peu connu », au même titre que le traitement d’urgence PEP (après exposition).
La Dre Julie Lajoie souligne également que l’épidémie de VIH au Manitoba prend une forme particulière, et résulte principalement de facteurs socio-économiques.
« La majorité des cas sont dus à l’injection de drogues. On sait que c’est un énorme problème ici. On a aussi une population autochtone qui est importante dans la région et qui a souffert de traumatisme et de stigmatisation dans les milieux de la santé. Ça crée une barrière et les dépistages dans cette partie de la population ne sont pas une priorité. Au Manitoba, on note aussi que l’épidémie est différente. Ici, les nouveaux cas de VIH concernent surtout les jeunes femmes. L’on peut alors parler d’inégalité dans certaines cultures. Par exemple, demander l’utilisation d’un condom peut ne pas être la bienvenue. En travaillant auprès des communautés, on sait que certaines femmes savent qu’elles sont infectées, mais leur partenaire leur interdit d’aller chez le médecin pour suivre un traitement. »
Une forme de violence et un contexte social qui différencie le Manitoba d’autres provinces comme le Québec ou l’Ontario où le VIH touche davantage les hommes qui ont des relations avec d’autres hommes par exemple.
C’est en tout cas ce que souligne le Canada’s Source for HIV and Hepatitis C Information (CATIE), dans un article paru en juillet 2024.
« Les chercheurs ont constaté que, parmi les récentes augmentations de cas de VIH au Manitoba, 45 % des personnes nouvellement diagnostiquées étaient des femmes. De plus, 76 % des nouveaux diagnostics concernaient des personnes s’identifiant comme Autochtones. La majorité des nouveaux cas (61 %) s’identifiaient comme hétérosexuels et 72 % ont déclaré s’injecter des drogues, le plus souvent de la méthamphétamine. Plusieurs des personnes nouvellement diagnostiquées ne disposaient pas d’un logement stable. »
L’importance du dépistage
Le nerf de la guerre reste le dépistage.
Sans dépistage, le virus reste invisible et la transmission n’est pas entravée.
D’autant plus que les personnes infectées peuvent rester asymptomatiques pendant de longues périodes après infection.
« Plus vite on peut se faire traiter, moins on a de chance de contaminer, et plus on offre de chance à notre système immunitaire de s’en sortir », explique la docteure.
Julie Lajoie estime que la communication et la prévention autour du VIH et de l’importance du dépistage ne passe pas par les bons canaux de communications.
« Beaucoup de campagnes se font sur Internet, mais les populations à risque n’y ont pas nécessairement accès. Lorsque l’on parle aux communautés, on nous demande pourquoi l’on n’en parle pas à la radio ou à la télé. »
Elle préconise un retour « à la base », et des campagnes massives de prévention qui expliqueraient ce qu’est le VIH et comment s’en protéger.
« Je pense que l’on a besoin de ça. Il faut revenir éduquer dans les écoles, resensibiliser. Il faut que se protéger et se faire dépister redevienne une habitude. Même chez nos médecins de famille. Au moins une fois par an, que l’on soit à risque ou non. »