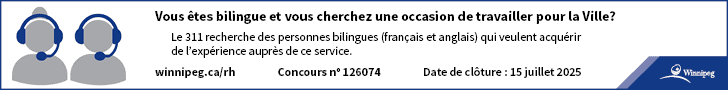Par Bernard BOCQUEL
Jusqu’à preuve du contraire, excluons d’entrée de jeu une provocation. Admettons que les hauts responsables qui ont décidé de faire des économies en confiant la direction du Bureau de l’éducation française (BEF) à un sous-ministre anglophone n’y ont vu qu’une mineure restructuration interne.
Sûrement ils n’ont pas mesuré combien leur décision politico-administrative touchait en plein coeur le dispositif de l’éducation en français dans la province. Et c’est bien parce qu’ils ne mesuraient pas les implications de leur décision qu’il faut affirmer avec certitude qu’ils doivent impérativement faire marche arrière.
Guy Roy a été sous-ministre adjoint en charge du BEF de 1982 jusqu’à sa retraite en 2004. Cet homme, qui se fait en tout temps un point d’honneur de s’exprimer avec pondération, résume ainsi les conséquences de la nomination de Rob Santos à la tête du BEF :
« Si gentil soit ce monsieur, il est impossible qu’il puisse être en bonne résonnance avec les préoccupations des éducateurs francophones. C’est au BEF, en consultation avec la francophonie, d’établir les visées éducatives pour notre société. Nous avons le droit de décider pour nous-mêmes. Nous avons le droit d’exercer un contrôle, dans le meilleur sens du terme, pour assurer notre épanouissement. On ne peut pas passer son temps à expliquer ce qu’on est en train de faire. »
Jusqu’à la venue au monde de la Division scolaire franco-manitobaine en 1994, le BEF était la pièce maîtresse centrale de l’éducation en français dans notre province. Une position quasi sacrée quand on sait à quel point l’éducation a toujours constitué le centre existentiel de la vie en français.
Les acteurs aux origines du Bureau de l’éducation française encore de ce monde sont bien placés pour savoir que rien n’est jamais acquis ; que la notion même d’acquis est fallacieuse. La volonté politique est essentielle en tout temps. Les pionniers de la mise en oeuvre de la Loi 113 de 1970 sur l’enseignement en français ont pu compter sur l’appui d’un homme d’exception, le sous-ministre Lionel Orlikow, c’est-àdire le fonctionnaire en chef au ministère de l’Éducation.
À ses débuts en 1974, le BEF n’a pas encore rang de « division » au sein du ministère. Il ne s’agit que d’une « direction », puis de deux, de trois. Ce n’est qu’à la mise sur pied d’une quatrième « direction », la Direction de ressources éducatives françaises (DREF) en 1983, que le BEF devient une « division » à part entière au ministère de l’Éducation.
Et c’est alors seulement, au nom du principe que l’autorité va avec les responsabilités, que le patron du BEF a commencé à acquérir un poids au sein du ministère. Jusqu’à avoir, lorsque les circonstances le permettent ou l’exigent, l’oreille du ministre. C’est ce rôle de conseiller du ministre, et du Cabinet sur demande, ce potentiel d’influence que le monde de l’éducation en français vient, entre autres, de perdre.
Encore une fois, refusons d’imaginer la moindre intention négative à ce gouvernement qui a soumis au vote des députés en juin 2016 sa Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine. Exigeons plutôt qu’il consulte avant tout geste impliquant la francophonie le Conseil consultatif établi dans le cadre de cette loi-là.
Dans l’éventualité où le gouvernement ne saisirait pas la totale incohérence de son geste à l’endroit du projet de vie des bilingues français-anglais de la Province du Milieu, préparons-nous à un geste fort. Un geste qui pourrait venir d’un mouvement de parents pleinement conscients que l’éducation de leurs enfants passe avant d’étroites considérations financières. Comme une journée où ils n’enverraient pas leurs enfants à l’école, par exemple et pour commencer.