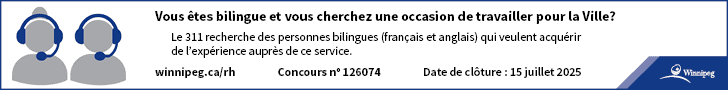Par Bernard BOCQUEL
Les discussions en cours pour (on l’espère) arriver à une sortie de crise honorable afin de remettre le Bureau de l’éducation française sur les bons rails fournissent une bonne occasion pour, notamment, réfléchir sur la pertinence de l’adjectif qui qualifie ce Bureau.
Mais avant de se pencher sur l’adjectif « française », arrêtons-nous d’abord sur la pertinence du mot « Bureau ». Il va nous permettre de souligner d’emblée l’importance de procéder à des ajustements de vocabulaire quand vient le temps de consacrer une évolution historique. L
orsqu’en 1970 le gouvernement néo-démocrate d’Ed Schreyer passe la Loi 113 qui redonne la possibilité d’enseigner non seulement du français, mais en français, tout reste à faire sur le plan pédagogique. Au ministère de l’Éducation est mise en place dès 1971 une cellule chargée d’élaborer un programme pour enseigner en français. Elle est baptisée « Section française ». À l’époque, on milite pour des « écoles françaises ». Personne ne penserait à « écoles françaises de France ».
C’est le mot « Section » qui fait un peu étriqué. Pour asseoir le sérieux du travail effectué par les pédagogues, en 1974 on rebaptise la cellule « Bureau de l’éducation française ». En bref, BEF. Un « coordonnateur » en a la charge. C’est un haut fonctionnaire québécois, Olivier Tremblay, qui relève directement du sous-ministre, Lionel Orlikow. Bras droit du ministre de l’Éducation, Orlikow et ses alliés réussissent en 1976 à conférer une légitimité supplémentaire au Bureau de l’éducation française en plaçant à sa tête un « sous-ministre adjoint ».
Or, au ministère de l’Éducation, un sous-ministre adjoint s’occupe au moins d’une « Division ». Le Bureau acquiert le statut de Division en 1983, à la création d’une quatrième « direction » au sein du BEF, la Direction des ressources éducatives françaises, la DREF. Mais à ce moment-là, on nage en pleine crise de la constitutionnalisation avortée de services gouvernementaux en français. La dernière des préoccupations aurait alors été de changer le nom de « Bureau de l’éducation française » à « Division de l’éducation française ». D’ailleurs pourquoi risquer de faire des vagues? Il y a déjà assez de fonctionnaires anglophones qui avalent mal l’existence même du BEF.
Lorsque finalement les luttes juridico-politiques d’un groupe de parents archi-motivés ont permis la naissance en 1994 de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM), le sens de l’adjectif « français » avait évolué. Les écoles dont la DSFM avait la responsabilité étaient de moins en moins vues comme des « écoles françaises », mais plutôt des « écoles francophones », voire des « écoles francomanitobaines ». Au ministère de l’Éducation, les équipes chargées de développer des programmes scolaires pour les écoles francophones et d’immersion oeuvraient cependant toujours au BEF.
Le BEF a continué de faire sans vagues son travail jusqu’à l’automne 2017, lorsque le culte de la réduction des dépenses publiques cher au gouvernement Pallister a entraîné l’élimination du poste de sousministre adjoint chargé de la « Division du Bureau de l’éducation française ». Aux yeux du gouvernement, une réorganisation mineure. Aux yeux des personnes clés dans le monde de l’éducation en français, un nonsens. Le ministre de l’Éducation a accepté qu’un comité réexamine le dossier.
Souhaitons bien sûr que la raison prévale pour préserver l’intégrité et l’autorité d’une des pièces essentielles du dispositif éducatif en français. Souhaitons aussi que le BEF actualise enfin son nom, qu’il se présente à la mesure de l’enjeu réel : le bilinguisme fonctionnel d’une autre génération, le projet canadien par excellence. Si la jeunesse d’ici allait enfin à l’école canadienne, ne serait-il pas juste que les programmes scolaires soient officiellement pensés par une « Division de l’éducation canadienne »?