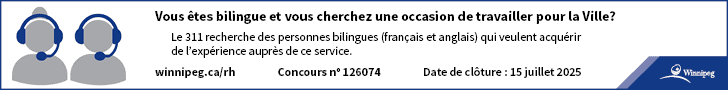Par Bernard BOCQUEL
Les Québécois sont en campagne électorale. Pour la première fois les chefs des partis vont tenir un débat télévisé en anglais; et deux en français, primauté institutionnelle du français oblige.
Dans notre monde toujours plus globalisé, une certaine compréhension de l’anglais s’avère bien pratique pour aller à la rencontre d’étrangers. Dans les milieux des affaires et des sciences, l’anglais est depuis belle lurette la lingua franca planétaire. Autant d’évidences qui n’échappent évidemment pas aux Québécois. Mais de là à défendre ouvertement les mérites d’un bilinguisme fonctionnel français-anglais, c’est une autre affaire. Au point où on se demande si là ne résiderait pas le tabou québécois par excellence.
Mais qu’est ce qui pourrait bien justifier pareil blocage? La langue française au Québec a-t-elle vraiment besoin de faire comme si l’anglais n’existait pas pour maintenir sa légitimité?
Hors Québec, l’insécurité linguistique est un concept en vogue pour expliquer les hésitations de certains jeunes à s’exprimer en français. Un phénomène facile à saisir quand on sait que dans la plupart des milieux très anglophones, la jeunesse bilingue a conscience d’avoir moins de flexibilité en français. Mais l’insécurité linguistique à la québécoise, cultivée par des considérations politico-nationalistes, place psychologiquement le francophone en état d’infériorité. Ce qui ne peut être que contre-productif.
Dans notre monde globalisé qui opère sur le modèle dominant-dominé, le maître politique impose sa langue. Un vieux jeu. Lorsque François 1er édicta l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, il décidait que sa langue françoise rendrait dorénavant la justice. Lorsque la Couronne britannique prit le contrôle de la Nouvelle- France en 1763, les Canayens furent priés de switcher à l’anglais. Ne l’entendant pas de cette oreille, commença alors une très longue lutte à l’usure linguistique.
En 1969, les tenants de l’anglais comme langue unique pour assurer l’unité du pays furent obligés de faire une concession : la Loi sur les langues officielles, dont le but était simple : que dans leurs rapports avec l’État fédéral, les francophones ne subissent plus aucun désavantage lié à leur langue. Cette fois les Canayens (devenus des Québécois à ce moment-là) avaient gagné. Ceux vivant dans les provinces anglophones obtenaient la chance d’entretenir un bilinguisme fonctionnel. Un avantage bilingue accordé de fait aux enfants de parents anglophones dont les plus clairvoyants envoient leurs enfants dans des écoles d’immersion française.
Alors que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau entre dans la dernière année de son mandat, il est toujours question de « moderniser » la Loi sur les langues officielles. Ce travail législatif est devenu une nécessité afin de prendre en compte les nouvelles réalités sociétales et l’évolution des mentalités. De fait, le bilinguisme de concession d’il y a cinquante ans s’est progressivement assoupli.
Même les Anglo-Montréalais purs et durs qui répugnent encore à apprendre le français chez eux doivent reconnaître que le bilinguisme sert l’unité du pays. Quant aux indépendantistes québécois, force leur est d’admettre que les jeunes générations ne croient pas trahir le français en s’exprimant couramment en anglais. Comme perspective d’avenir, il ne reste aux partisans d’un Québec souverain que l’option d’entretenir le tabou sur un bilinguisme franchement assumé.
Gageons que les temps sont propices pour tourner la page du bilinguisme de concession et que l’heure est venue de s’engager enfin dans l’aventure du bilinguisme d’adhésion. Dans cet esprit nouveau, la «modernisation » de la Loi sur les langues officielles doit être comprise comme une « canadianisation » de cette loi emblématique de nos valeurs d’ouverture et de diversité, qui s’opposent à la logique du dominant-dominé.
Et qui sait si un jour la société québécoise ne réussira pas son retournement de mentalité : adhérer à l’anglais ouvertement et sans complexes pour mieux vivre libre en français.