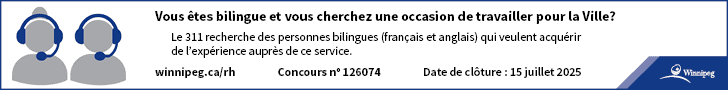Jen Funk a participé à la création du drapeau Franco-queer qui avait flotté une première fois devant l’hôtel de ville de Saint-Boniface durant la semaine de la fierté, à la fin mai 2018. Artiste impliquée et femme transgenre, elle a accepté de partager son expérience et de parler de sa transition à La Liberté.
avec des propos recueillis par
Catherine DULUDE
Vous avez 30 ans. Quand vous êtes-vous rendue compte qu’il y avait une dissonance fondamentale en vous?
Jen Funk : J’en ai pris conscience vers mes 17 ans. C’était très difficile à définir. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer. C’était comme un sentiment d’appartenance qui cherchait à émerger. Je viens de la campagne, là où il y a plus de volonté à se conformer. Je n’étais pas vraiment consciente de ce que cela voulait dire.
En avez-vous parlé autour de vous?
Quand j’ai réalisé que j’étais transgenre, vers mes 20 ans, j’ai commencé à en parler à un docteur. Il m’a dit qu’une transition était très chère. Au lieu de me donner les ressources pour en savoir plus, il m’a découragée. Alors je me suis dit : Ce n’est pas pour moi, mais juste pour ceux qui peuvent se le permettre. Alors j’ai continué ma vie comme un homme. Mais il y avait toujours quelque chose au fond de moi qui n’était pas à l’aise. Je ne l’ai compris que plus tard. Ma transition a été très longue. Vraiment, elle aurait pu commencer il y a dix ans.
Comment ont réagi vos proches?
Ce n’était pas facile. Surtout à cause de mon état de santé mentale. Je suis atteinte d’un trouble schizo-affectif. Et je me suis affirmée femme transgenre à un moment où beaucoup de monde avait peur pour moi. J’étais déprimée, j’ai fait des tentatives de suicide. Je n’étais pas vraiment moi-même. C’était une période sombre de ma vie. C’était difficile, parce que certains de mes proches rejetaient mon sentiment de fond en pensant que c’était la psychose qui parlait. Mais mes psychiatres ont reconnu que c’était deux choses complètement différentes. Ce n’était pas ma maladie.
Votre famille a cependant fini par voir que ce n’était pas la maladie qui parlait…
Oui, parce que je n’ai jamais lâché. En 2015, j’ai vraiment réalisé que je ne pouvais plus me mentir. C’était encore difficile, parce que j’étais à l’hôpital à ce moment-là. Mais je me suis dit : Non, je vais continuer à me présenter de cette façon, celle qui me rend heureuse. J’étais tenace. Je me suis battue.
Vous avez aussi été très active sur les réseaux sociaux à ce moment de votre vie…
Au début, ça faisait du bien. Puis, c’est devenu un problème, parce que l’on pouvait presque voir la maladie dans ce que je publiais. Je relisais souvent ce que j’écrivais, j’avais des regrets. J’ai décidé de supprimer ce compte. J’avais besoin de faire disparaitre cette période sombre de ma vie. Ça a fait du bien de tout lâcher pour recommencer à nouveau.
Étant aujourd’hui saine, en santé, je trouve ça important de partager mes progrès. Je souhaite briser les tabous. Parce que je suis consciente que c’est encore une lutte pour beaucoup de personnes de parler de leurs troubles.
Qu’est-ce qui vous a aidée à tenir?
Mes amis et ma famille ont été un grand soutien. Durant l’été 2017, j’ai organisé un social pour m’aider avec les coûts de ma transition. Il y avait tellement de gens que je n’avais pas vu depuis des années. Tant de gens étaient là pour me soutenir. Ça m’a fait beaucoup de bien.
Vous avez commencé le traitement hormonal en janvier 2017. Comment se déroule votre cheminement?
C’est long. Souvent, les jeunes transgenres sont pressés et veulent que le processus soit rapide. Mais ça demande beaucoup de force et de patience. Beaucoup d’organismes et de professionnels entrent en jeu. Mon médecin, mes psychiatres et la clinique sont en contact permanent. Je suis chanceuse, car la majorité des coûts est couverte par le medicare. Je paie des coûts supplémentaires d’environ 125 $ par mois. Ça a tellement changé ma vie. Ça n’a pas vraiment de prix.
Quelles sont les prochaines étapes?
Je discute de la reconstruction avec les psychiatres. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Comme prendre rendez-vous avec une spécialiste de la pilosité. Il n’y en a qu’une seule dans la province et ça prend un an avant de la voir. En ce moment, je veux juste me focaliser sur ma santé mentale et mon adaptation. Ça me va de prendre mon temps pour chaque étape.
Votre art doit jouer un rôle dans votre cheminement personnel…
Dans le passé, j’ai utilisé l’art de façon thérapeutique. Mon dernier show solo était au sujet de ma vie personnelle. À la fin de l’exposition, j’étais complètement épuisée émotionnellement. C’était vraiment difficile, juste à cause du sujet, qui était personnel et assez lourd, il faut le dire. Maintenant, je travaille sur quelque chose de plus objectif.
Quel est votre plus grand rêve, dans votre transition?
Arriver au moment où je n’aurai plus besoin de m’excuser d’être qui je suis. Cela m’arrive encore d’aller à un magasin et d’avoir un « monsieur » au lieu de « madame ». Ce n’est pas grave, ce n’est la faute de personne. Je ne suis plus la personne conflictuelle que j’étais. Ce qui est important, c’est quand quelqu’un me voit pour qui je suis et m’accepte, c’est quand je me sens bien avec moi-même. C’est ça qui me forge le plus.
Et qui vous renforce dans votre parcours de vie?
Ça n’a pas été facile, mais aujourd’hui je suis heureuse. Les choses vont bien. J’ai été chanceuse dans mon parcours. J’ai une communauté d’amis et une famille qui me soutiennent. Je m’adapte encore à certains changements sociaux. En anglais, c’est facile de parler de soi sans genre. Il me faut encore le temps de réapprendre à parler en français, car c’est une langue très genrée. Ce qui est important pour moi à ce stade, c’est de rester attentif aux symptômes, prendre du temps pour moi et rester proche de mon groupe médical.