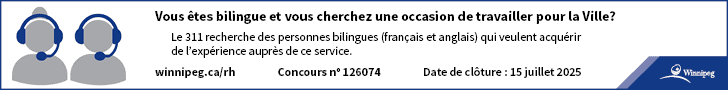Hoorieh Rezasoltani a appris le français dans son pays natal, l’Iran, encouragée par ses parents. Aujourd’hui, la littérature française est pour elle un choix de carrière : la doctorante en langue et littérature française inscrite à l’Université du Manitoba depuis septembre 2018 veut se servir des auteurs canadiens-français pour rapprocher le Canada de l’Iran.
Par Mathilde ERRARD
La porte s’ouvre sur une jeune femme apprêtée, pantalon blanc, petit chemisier coloré assorti à une veste bleu roi. Son appartement est tout aussi à son image : soigné. Tout y est parfaitement en ordre.
Hoorieh Rezasoltani, 28 ans, est née dans la capitale de l’Iran, Téhéran. Dans sa famille, on parle la langue officielle, langue majoritaire et enseignée à l’école : le farsi, ou persan.
Mais la jeune femme n’en est pas restée là. Son père revient souvent dans la conversation à son amour pour les langues. L’entrepreneur dans l’industrie du textile apparaît en effet comme un moteur, avec sa femme, dans l’apprentissage des langues de leur fille.
« Mon père parle farsi et anglais. Il voyage beaucoup et est donc souvent en contact avec d’autres cultures. Pour lui, ça a toujours été important d’apprendre de nouvelles langues pour être connecté au monde, aux différentes cultures, et comprendre les sociétés en profondeur. »
C’est en 2003 que Hoorieh Rezasoltani vit sa « première rencontre avec la langue française », à Paris, à l’occasion d’un voyage en Europe avec sa famille.
« J’avais déjà entendu du français avant, dans des films par exemple. Mais c’est lors de ce voyage que j’ai réellement prêté attention à cette langue. Au premier abord, c’était assez bizarre, même surprenant. La prononciation est tellement différente du persan! Par exemple, la consonne « R » est très utilisée en français, mais très peu dans ma langue maternelle.
« Puis, le français est devenu comme une musique pour moi. D’ailleurs, c’est après ce voyage que j’ai eu envie d’apprendre le français. »
À son entrée en licence dans une université à Téhéran, Hoorieh Rezasoltani a dû faire un choix : soit elle continuait dans le domaine des sciences qu’elle avait choisi pour son baccalauréat à 18 ans (équivalent du diplôme de 12e année), soit elle changeait de voie pour aller en traduction française.
Une décision difficile à prendre dans un pays qui privilégie les sciences. « La majorité des Iraniens choisit de travailler dans le domaine des sciences ou de la physique, ou d’être ingénieurs, par exemple. Les parents encouragent plutôt leurs enfants vers cette voie, parce qu’il y a plus d’opportunités et ce sont des métiers mieux payés.
« J’aurais pu continuer en sciences et trouver facilement un emploi en Iran, notamment grâce aux contacts de mon père. Mais j’ai fait le choix de faire ce que j’aime : de la littérature française. »
Son apprentissage du français ne s’est pas déroulé sans difficulté. L’écriture farsi est en effet très différent du français. Il s’écrit notamment de droite à gauche. Elle ajoute : « La conjugaison aussi est différente, et il n’existe pas de masculin ni de féminin pour désigner des objets. »
Hoorieh Rezasoltani ne se décourage pas pour autant. Après sa licence, elle fait un master en traduction française dans son pays natal.
Aujourd’hui, le français en Iran est principalement enseigné dans des écoles privées et dans certaines universités qui possèdent des filières en français. La jeune femme précise : « Le français est, après l’anglais, la deuxième langue étrangère que les Iraniens préfèrent apprendre. Il y a beaucoup d’opportunités lorsqu’on sait parler ces deux langues, notamment dans le tourisme. »
Aujourd’hui, Hoorieh Rezasoltani est doctorante en langue et littérature française à l’Université du Manitoba. « J’aurais pu choisir la France pour continuer mes études, mais, j’ai préféré un pays bilingue. C’est plus facile pour moi, et puis je peux à la fois améliorer mon anglais et mon français. »
L’étudiante est par ailleurs arrivée au Canada avec un projet en tête : créer des relations entre les universités canadiennes et iraniennes. Et ce, par le biais de la littérature francophone canadienne qu’elle compte étudier en profondeur dans sa thèse. « En Iran, les cours portent principalement sur la littérature de France, donc je veux devenir plus familière avec les auteurs francophones canadiens.
« Il serait intéressant de développer la recherche en Iran et de traduire des œuvres canadiennes en persan, et inversement. Ou d’organiser des conférences en Iran sur des auteurs francophones canadiens. »
Créer des partenariats entre l’Iran et le Canada peut s’avérer compliqué. Il n’existe plus depuis 2012 d’Ambassade canadienne en Iran. Et de plus, des tensions persistent autour de l’accord sur le nucléaire iranien.
Mais la doctorante est confiante : « Les démarches prendront peut-être du temps, mais tout est possible. Je ne pense pas que le domaine académique soit touché par la politique. »