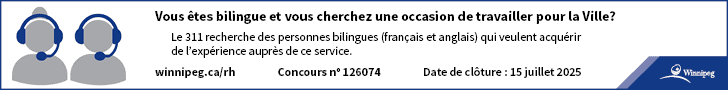Le sociologue Joseph Yvon Thériault étudie depuis longtemps les questions de société et d’identité des francophones au pays, notamment des communautés de langue française à l’extérieur du Québec. Il a accepté de répondre aux questions de Francopresse.
Par Marc POIRIER – Francopresse
Joseph Yvon Thériault est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 2008, après avoir enseigné à l’Université d’Ottawa pendant 30 ans (1978 à 2008), où il a notamment été titulaire de la Chaire de recherche identité et francophonie.
Acadien, originaire de Caraquet au Nouveau-Brunswick, il est l’auteur de nombreux essais dont Faire société : société civile et espaces francophones, un essai dans lequel il analyse les tribulations identitaires de l’Acadie et des francophonies minoritaires du Canada.
Q : Treize ans après Faire société, comment se situe la francophonie à l’extérieur du Québec dans sa quête de former une réelle communauté d’un océan à l’autre?
Joseph Yvon Thériault : Depuis la Charte des droits de 1982, il y a un débat à savoir si les francophones sont « une nation », dans le sens qu’ils feraient partie de l’ancien Canada français, l’idée des deux nations au Canada. Est-ce qu’on fait partie de la nation canadienne ou est-ce qu’on fait partie de la diversité canadienne sur le côté de l’ethnicité, sur le côté du multiculturalisme, etc.?
Plusieurs associations, surtout dans l’Ouest canadien, ont dit à un moment donné qu’il faudrait se présenter davantage à travers la diversité canadienne et moins à travers la dualité canadienne. Faire société, ça touche cette question-là en se demandant qu’est-ce qu’on est comme groupe. Et je maintiens que la grande intention du grand projet du Canada français, c’est une proposition « nationalitaire », nationaliste, et non une proposition ethnique.
La distinction que je fais, c’est dire que la nation, elle veut faire société, elle veut des institutions. Une identité plus ethnoculturelle, c’est une identité beaucoup plus liée à la mémoire.
Aux États-Unis, les groupes ethnoculturels ne demandent jamais d’écoles séparées. Ils veulent être intégrés. Donc l’idée de Faire société, c’était de dire que le projet de la francophonie canadienne est de s’intégrer dans une proposition nationale. Et, un peu en arrière-plan, c’est l’idée que la provincialisation des identités a un peu rendu difficile ce projet-là parce qu’on a voulu, depuis les années 1960, faire société ou faire nation dans chacune des provinces. Chacune des provinces a voulu ses propres institutions et donc la fragmentation de la francophonie conduisait un peu à un émiettement.
Q : Quand on parlait du Canada français à l’époque, y avait-il une connotation ethnique?
J.Y.T. : Pas nécessairement, parce que le Canada français n’était pas qu’une identité ; c’était un réseau social. Il y avait des collèges, des couvents, puis il y avait des institutions, des journaux, une histoire. Fernand Dumont (sociologue et philosophe québécois, 1927-1997) disait qu’on pouvait devenir Canadien français. Les Irlandais qui se sont mariés avec des francophones sont devenus Canadiens français ou Acadiens.
François-Xavier Garneau (historien québécois, 1809-1866), dans la première Histoire du Canada, a indiqué clairement que tous les groupes ethnoculturels qui sont venus en Amérique comme immigrants se sont intégrés à la société anglo-américaine, et que nous seuls, les francophones, on a refusé ça pour faire œuvre de civilisation en Amérique.
Il y a donc un projet de « faire société » qui n’est pas ethnoculturel, dans le sens où ce n’est pas qu’une survivance ethnique, ce n’est pas une frontière ethnique, c’est une frontière sociétale.
Fernand Dumont avait un bel exemple. Dans les années 1950, il va au Manitoba, à Winnipeg. Le curé de la paroisse de Saint-Boniface lui dit : « Écoutez, j’ai un problème avec les Métis. Ils veulent que je dise la messe en anglais. Je leur ai dit : Il y a une paroisse catholique anglophone l’autre côté de la rue. Pourquoi vous n’allez pas là? Ils m’ont répondu : Because we are French Canadians ». Ils s’associaient au Canada français par le village, par l’institution, par la société, mais pas par la langue.
Q : Plusieurs institutions franco-canadiennes « hors Québec » ont été créées au fil des ans, que ce soit en éducation, en culture, en santé, en cinéma, etc. Jusqu’à quel point cela démontre-t-il une volonté de créer cette société dont vous parlez?
J.Y.T. : J’ai l’impression que les capacités organisationnelles se sont accrues et ont renforcé la francophonie, mais elles n’ont pas pallié le fractionnement de la francophonie. C’est-à-dire que les francophones — probablement à l’exception de ceux du Nouveau-Brunswick — se sont dispersés, ce qui les a affaiblis parce qu’il n’y a pas eu de concentration dans des villes. Le seul lieu urbain que les francophones développent à l’extérieur du Québec, c’est Dieppe (près de Moncton, au Nouveau-Brunswick).
La réponse à cette faiblesse ou à l’éparpillement, c’est la réunification de la francophonie sur une base pancanadienne — et ça, ça inclurait le Québec aussi — en disant que, si on est faibles numériquement, on compense ça par le fait qu’on participe à une population qui est plus grande.
Q : Quelle serait la prochaine étape?
J.Y.T. : Je pense qu’on le voit dans le milieu culturel hors Québec, qui fait de grands pas en faisant des partenariats avec le Québec. On ne peut pas avoir une culture sociétale, une culture nationale, avec 30 000 francophones au Manitoba, 1 000 en Alberta, etc. ; il faut qu’il y ait, quelque part, une unification – puis aussi au Québec.
Même les Acadiens du Nouveau-Brunswick savent très bien que pour que leur culture réussisse, il faut qu’une partie de leur public soit québécois. Dans les grandes institutions canadiennes comme Radio-Canada, l’Office national du film, etc., les francophones hors Québec, les Acadiens surtout ont critiqué leur absence et n’ont pas essayé de trouver un partenariat intéressant pour gérer avec le Québec les associations nationales qui sont panfrancophones. Donc il y aurait toute une culture franco-canadienne à développer.
À lire aussi : Une autre histoire de Radio-Canada
Q : Donc il y a encore une crainte de se faire diluer ou que le Québec ne prenne le dessus?
J.Y.T. : Dans les années 1960, les francophones de l’extérieur du Québec ont perçu que les Québécois ne faisaient plus partie de leur «famille» d’une certaine façon. Cela a permis un retour sur leur identité propre, mais en même temps, un certain affaiblissement du lien culturel. Je pense que la situation change aujourd’hui — pas uniquement parce que les francophones ont besoin de cette diffusion plus large — mais aussi parce qu’au Québec, il y a plus d’ouverture.
Tout ça pour dire que si on est une nation, si on veut faire société, on ne peut pas faire ça dans son village. On peut vivre son ethnicité dans son village, mais on ne peut pas vivre une culture sociétale. Une culture sociétale, ça demande un espace plus large, un certain détachement. Ça demande de grandes institutions. Seule une densité démographique peut survivre. Il y a un niveau où on n’est pas assez pour faire société.