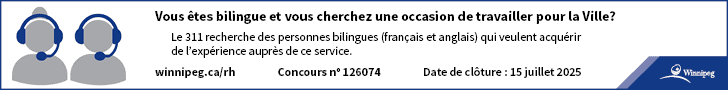Qu’est-ce qui vous a amenée en éducation?
Ce n’était certainement pas mon intention en sortant du secondaire (rires). Comme jeune personne, je me suis mariée et j’ai déménagé à Saint-Claude. Dans le village, il n’y avait pas beaucoup de postes alors j’ai pris un poste d’auxiliaire dans l’école.
Quand je suis arrivée à l’école, il y avait des enfants qui étaient tellement bilingues. Ils passaient d’une langue à l’autre avec tellement d’aisance. J’étais admirative.
Parce que vous n’aviez pas eu cette chance…
En effet, j’ai fait mon école en anglais. J’ai grandi à Vancouver à l’époque où il n’y avait pas d’écoles françaises. On parlait le français uniquement à la maison, le reste de la vie se faisait en anglais. De plus, la maison n’était pas pleine de livres en français. Nous étions une grande famille, les moyens étaient limités, je n’avais donc jamais lu en français, ni écrit.
Je comprends mieux votre admiration envers ces enfants…
Oui. J’étais même un peu gênée face à eux alors j’ai décidé de suivre un cours de français pour m’améliorer. Je me suis lancée à l’Université de Saint-Boniface avec Antoine Gagné, qui était une perle. Il était l’un de ces enseignants qui te donnaient le goût de réussir. Et il m’a donné le goût de l’enseignement. C’est comme ça que j’ai commencé un baccalauréat en éducation en 1987 et je l’ai complété en 1993.
En plus des études, je travaillais et j’élevais mes enfants.
Vous avez donc commencé votre carrière juste avant la création de la DSFM…
Exact. Ma première affection était à Notre-Dame-de-Lourdes. C’était l’année où il fallait décider de rejoindre la DSFM ou bien de rester avec la division scolaire cédante. J’ai fait le choix de rejoindre la DSFM dès sa création parce que je croyais en ce projet.
Outre rejoindre cette division, comment vous êtes-vous mobilisée pour plaider pour les écoles en français?
Mes enfants étaient à l’école à Saint-Claude. Tout de suite, plusieurs parents ont souligné leur intérêt dans le projet de création d’une division scolaire.
Comme parent, j’ai lutté fort pour avoir une école en français à Saint-Claude. Comme enseignante, j’ai toujours adhéré à l’école en français. Je voulais que mes enfants aient accès à une éducation de qualité en français dans leur village. C’était la même chose pour les parents qui ont appuyé cette école.
Comme s’est traduite votre lutte?
En 1997, j’ai pris un congé sans solde pour mettre sur pied l’école française de Saint-Claude. Ensuite, cette école a rejoint le réseau de la DSFM et je suis retournée travailler pour eux.
Nous étions un noyau dur de parents qui exprimaient cette même volonté. Nos enfants étaient dans le programme à double voie mais nous voulions toujours avoir plus. Alors à cette époque, on voyait la possibilité de se faire entendre. Aujourd’hui, l’école est toujours sur pied et un gymnase est même en construction.
Y a-t-il eu des obstacles dans votre lutte?
Certainement. Mais je les ai vus comme des moteurs.
Déjà, tout simplement avoir la gestion de nos écoles a été un grand changement. Mais il fallait comprendre ce que ça signifiait. Il fallait aussi s’organiser avec la communauté francophone pour comprendre nos droits comme parents.
Ce n’était pas uniquement le droit à des écoles déjà existantes. Mais le droit de revendiquer des écoles dans d’autres communautés là où le nombre le permettait, comme à Laurier ou encore à Saint-Lazare. Il y a donc eu des moments de réflexion très intéressants comme commissaires scolaires, dirigeants d’écoles, pour comprendre le mandat de cette division scolaire.
Il a aussi fallu trouver des enseignants prêts pour cette école à Saint-Claude…
Quand j’ai commencé, en 1993, il y avait trop d’enseignants pour les postes disponibles. Contrairement à aujourd’hui. C’était donc très difficile de trouver un contrat permanent. À Notre-Dame-de-Lourdes, j’ai enseigné la musique en premier lieu. Aussi un peu l’anglais au secondaire avant de prendre mon congé.
Ensuite à Saint-Claude, après la mise sur pied de l’école française, j’ai enseigné, pendant dix ans presque toutes les matières sauf les mathématiques, à tous les âges. Il fallait le temps de recruter des enseignants prêts à venir à Saint-Claude. Il n’y a pas un niveau scolaire que je n’ai pas fait. Chaque niveau avait son cachet. Il y avait des défis différents pour tous les niveaux.
Après ces dix années, j’ai été directrice de l’École Christine-Lespérance pendant cinq ans.
Vous êtes devenue en 2019 directrice générale adjointe de la DSFM. Vous connaissez tous les recoins de la division…
Je regarde l’évolution de la DSFM avec grande fierté. Je me dis aussi que j’ai contribué à cette évolution. Dans les derniers postes que j’ai occupés, directrice de la programmation et directrice générale adjointe, j’ai eu la chance de travailler avec mes homologues anglophones, j’ai pu m’apercevoir que la DSFM est à la hauteur de ce qu’on peut attendre de l’éducation au Manitoba. Nos élèves performent très bien. Nos homologues nous respectent aussi. Quand on a commencé, ce n’était pas toujours évident et facile. Cependant, personne n’a jamais baissé les bras et le travail a continué de se faire.
C’est la même chose à l’échelle du pays, la DSFM est à la hauteur des autres programmes de français en milieu minoritaire.
Je quitte alors que mes petits-enfants sont à la DSFM et j’ai confiance qu’ils ont une bonne éducation. Elle va leur permettre de grandir et de s’épanouir dans leur langue maternelle.
Qu’est-ce qui vous encourage dans le milieu éducatif?
Je quitte en paix. La division a beaucoup évolué et appris. Il reste encore beaucoup à apprendre. Nos salles de classe sont des petits environnements avec une variété de besoins. Cependant je constate qu’il y a un appui et un engagement consistant de la part des éducateurs et du personnel de nos écoles à donner le meilleur à nos élèves.
Le niveau d’engagement m’a toujours impressionnée. Comme parent, ce n’est pas évident d’élever ses enfants en français en milieu minoritaire. Les parents posent déjà un gros geste. Pareillement du côté de nos enseignants. Ce n’est pas évident, surtout quand il n’y a pas forcément les ressources. Mais tout le monde le fait pour l’amour de la langue.
Les enseignants peuvent justement être épuisés. L’éducation en français en milieu minoritaire connaît une pénurie de main-d’œuvre, est-ce inquiétant pour l’épanouissement de la langue?
C’est un défi de taille. Ce n’est pas un défi qu’on peut surmonter seule comme division scolaire. Nous avons des partenaires comme l’Université de Saint-Boniface qui travaille à augmenter sa capacité d’accueil d’étudiants. Le ministère de l’Éducation montre une volonté de travailler sur le recrutement d’enseignants qui parlent le français.
Il y a des initiatives un peu partout au pays pour encourager des carrières en éducation. Cependant, il faut compter cinq ans pour devenir enseignant, alors même si on veut augmenter les ressources humaines, il y a des besoins immédiats.
Le milieu est fatigué, la pandémie a eu des effets importants sur les éducateurs et les éducatrices. Je dirais que lorsqu’on a un rôle qui consiste à prendre soin des autres et qu’il faut mettre ses propres soucis de côté, l’épuisement se fait sentir. La pandémie a exacerbé ce problème.
Sauf que lorsqu’un enseignant part, il n’y a pas forcément la main-d’œuvre pour le remplacer. C’est quelque chose qui m’inquiète.
Les gouvernements parlent beaucoup d’immigration pour pallier la pénurie de personnel. Pourtant, en éducation, la plupart des immigrants doivent reprendre des études pour faire valoir leur diplôme. Y a-t-il des améliorations à apporter de ce côté?
C’est une grosse partie de nos discussions avec nos homologues et avec le ministère de l’Éducation. La reconnaissance des acquis est un gros dossier. Il faut aussi s’attarder sur l’intégration et la réussite sociale de nos immigrants. Nous reconnaissons qu’ils ont toutes les compétences pour enseigner. Cependant, ils viennent de milieux différents.
Nos attentes sont différentes, nos structures aussi. Il faut donc être certain que les immigrants comprennent tout notre système pour s’intégrer.
Mais certainement, c’est au cœur de nos discussions. Plusieurs organismes comme la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants mène des études et offre des pistes de solutions pour veiller à l’intégration des nouveaux arrivants.
Il faut donc arriver à concilier nos deux réalités puisque le bassin de recrutement est énorme. C’est important qu’on n’ignore pas cette richesse. De plus, c’est une belle valeur ajoutée à nos écoles et à notre francophonie.
Outre l’école de Saint-Claude, vous avez certainement mené d’autres dossiers…
Comme première directrice de programmation, j’ai pu manier un peu le poste comme je le souhaitais. J’ai donc pu mettre sur pied le poste de leader pédagogique.
Des enseignants chevronnés ont l’occasion de travailler avec d’autres enseignants dans leur salle de classe. C’est un appui pour les plus jeunes enseignants qui arrivent dans les écoles.
Ce sont des personnes clés qui transmettent leur savoir et qui peuvent aussi faire de la rétroaction sur les initiatives mises en place dans les classes.
Un autre morceau sur lequel j’ai pu travailler, c’est l’analyse des données. Comme directrice de programmation, j’ai établi un modèle sur comment jeter un regard sur les données sans être un analyste. C’est quelque chose qui semble porter ses fruits. On peut suivre l’évolution de nos élèves.
En parlant de données, le Recensement de 2021 a montré qu’il y avait un bassin de quelque 20 000 élèves à aller chercher pour les écoles de la DSFM. Comment voyez- vous ce chiffre?
C’est une donnée qui confirme ce que l’on savait déjà. Mais maintenant, c’est Statistique Canada qui le dit.
Nous allons pouvoir amener cette donnée auprès des différents ministères pour aller chercher du financement pour nos écoles. Soyons clairs, quand des élèves doivent faire 50 kms pour être dans une école en français, tu n’inscris pas ton enfant. Quand l’école est moins belle ou offre moins de programmation, tu n’inscris pas ton enfant.
Cette donnée va nous permettre de montrer au ministère qu’il peut nous faire confiance. Lorsque la DSFM ouvre une école, elle se remplit instantanément. Il va falloir maintenant savoir où sont ces élèves pour savoir où ouvrir des écoles.
Ce chiffre montre aussi que nous ne sommes pas assimilés. Nous devons juste trouver un moyen de les accueillir.
Du côté manitobain, le gouvernement travaille sur une nouvelle formule de financement. Est-ce que les données de Statistique Canada arrivent à un bon moment?
En général, un à un tu rencontres les parents, tu discutes, ils te disent qu’ils aiment l’école de quartier et ils apprécient l’enseignant.e de leur enfant. Mais comme société, le discours semble changer. C’est sur ce tournant qu’il va falloir travailler. C’est au-delà des dollars.
Si le discours public était différent, il y aurait de l’argent, l’éducation serait valorisée.
Les besoins sont de plus en plus grands. Si l’on veut être des écoles inclusives, le financement doit suivre. C’est injuste de dire Venez dans nos écoles, mais on ne peut pas vous offrir des services adéquats. C’est à l’échelle de la province.
On ne finance pas adéquatement l’éducation au Manitoba. Il faut le voir comme un investissement. Construire un enfant en santé coûte moins cher que de guérir un adulte.
Tant que le discours ne se renversera pas, la société ne comprendra pas que l’éducation est un investissement sur le long terme pour avoir des adultes en santé. Il est temps de changer de discours.
Un dernier mot pour vos collègues?
Je souhaite qu’ils finissent avec autant de satisfaction que moi. J’ai eu des temps de fatigue, des temps où j’ai été découragée, où j’ai été débordée. Mais tout en a valu la peine.