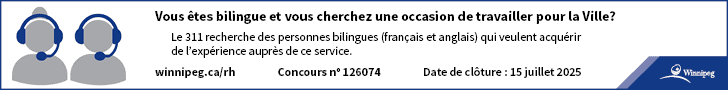Par exemple, en 2014-2015, une canicule marine le long de la côte ouest du Canada et des États-Unis, surnommée le Blob, a entraîné un déclin des populations d’un grand nombre d’espèces. Avec un effet domino : une recherche parue en 2019 avait ainsi établi que les pertes massives d’étoiles de mer avaient entraîné une explosion d’oursins (des proies pour les étoiles de mer), qui avait en retour endommagé les forêts de varech — de grandes algues brunes.
C’est en plus du fait que les températures plus élevées finissent par inciter des espèces à migrer vers des eaux plus froides, ou à rester trop longtemps dans certains secteurs : c’est dans ce contexte que l’on a observé l’an dernier un nombre anormalement élevé d’échouages de tortues marines près de Cape Cod, ou que des pêcheurs de crevettes de l’Acadie ont vu fuir leur gagne-pain vers le nord.
Mais au-delà de ces généralités, ces canicules marines restent en partie dans l’angle mort des recherches qui se situent à l’intersection du climat et de la biologie. Or, ces dernières années, ce n’est plus seulement à des records de température qu’on a assisté : les canicules marines sont plus intenses, durent plus longtemps et se produisent plus fréquemment qu’avant.
Pour les espèces les plus fragiles, celles qui ne peuvent tolérer qu’une fourchette étroite de températures — comme les coraux — ce sont des changements qui se produisent trop vite — quelques dizaines d’années — pour que ces espèces aient le temps de s’adapter. Pour les autres, celles qui peuvent se déplacer, il n’y a aucune garantie qu’elles retrouveront le bon garde-manger dans leur nouvel habitat.
Et c’est sans compter les impacts sur les humains, ceux dont les communautés locales dépendent depuis des générations de la pêche. En ajoutant à cela les pertes de l’industrie touristique, une recherche parue en 2021 évaluait à des milliards de dollars les impacts économiques des canicules marines.
Le fait qu’elles aient été si peu étudiées a pour conséquence, déplorent neuf experts en écologie marine, qu’on a de la difficulté à prévoir les impacts qu’aura le réchauffement sur ces écosystèmes, et que du coup, on peut difficilement aider les communautés locales à se préparer. Dans un texte d’opinion publié le 6 septembre dans la revue Nature, ils nomment quatre priorités :
- identifier les zones les plus à risque ; considérant que le phénomène El Niño amplifie le réchauffement, les régions que l’on sait déjà être les plus affectées (nord-est du Pacifique, centre-est, entre l’Équateur et le Pérou, est de l’Australie…) devraient faire l’objet d’une surveillance accrue ;
- améliorer les systèmes de prévision et d’alerte ; en dehors d’El Niño, on manque de données pour alerter une région sur le fait que la prochaine saison sera plus ou moins intense que les précédentes ; en fait, à ce jour, les prévisions pour les régions centrales des océans sont souvent meilleures que pour les régions côtières ;
- planifier au niveau local : à défaut de prévoir, il faudra réparer les dommages laissés aux industries locales par une canicule particulièrement désastreuse ;
- effectuer un suivi de ces impacts, pour être mieux outillé la fois suivante.
« La crise climatique, écrivent-ils, pourrait éventuellement amener les océans à atteindre un état de canicule permanent, par rapport aux normes historiques, et certaines régions pourraient ne plus être capables de soutenir certaines espèces et certains écosystèmes. Les écosystèmes qui émergeront pourraient ne pas opérer et répondre aux eaux plus chaudes d’une façon prévisible ». Mieux anticiper les impacts et mieux s’adapter « pourrait acheter du temps aux espèces, aux écosystèmes et aux industries qui en dépendent ».