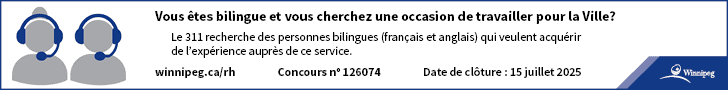D’ailleurs, dans son budget 2024, le gouvernement fédéral investira 500 millions $ pour soutenir les organismes de santé communautaire qui fournissent des soins de santé mentale aux jeunes. Malgré tout, la stigmatisation a la peau dure et certaines affections restent trop mal comprises, et trop craintes.
Il existe toujours, dans la société actuelle, une disparité dans la compréhension et l’acceptation des affections qui touchent à la santé mentale. À titre d’exemple, la parole se libère de plus en plus à propos de la dépression, des troubles anxieux ou alimentaires. En revanche, les maladies mentales telles que la bipolarité ou la schizophrénie sont davantage stigmatisées.
« Si l’on n’est pas capable de reconnaître les signes de dépression, est-ce que ce n’est pas en partie parce que la société n’en parle pas assez souvent? »
Clarissa Andrade
La parole se libère
Ce sont en tout cas les conclusions tirées lors d’une étude menée entre 1996 et 2018 aux États-Unis par la professeure de l’Université de l’Indiana, Bernice A. Pescosolido. L’étude démontre que le besoin de se distancier des personnes en dépression a diminué au fil du temps. Cependant, les gens associent de plus en plus la schizophrénie à la notion de dangerosité.
Malgré des résultats encourageants lorsqu’il s’agit de dépression, il reste encore du chemin à parcourir, et une meilleure tolérance sociale à la maladie ne signifie pas nécessairement qu’elle est mieux comprise. C’est ce qu’observe Clarissa Andrade. Psychologue de formation, elle est aujourd’hui coordonnatrice de services de soutien au bien-être et à la santé mentale à l’Université de Saint-Boniface, et explique que certains stéréotypes et stigmates ont la peau dure. « Le plus gros cliché c’est de dire que si je suis anxieux ou si j’ai une dépression c’est parce que je ne suis pas assez fort. Beaucoup de gens associent encore les troubles en santé mentale au fait d’être faible. » Une tendance qui se fait ressentir davantage dans la population masculine.
Mais le problème ne vient pas seulement des a priori. Les effets d’une fièvre, par exemple, sont plus concrets, mieux connus. Un individu souffrant de fièvre sait qu’il souffre de fièvre et n’aura donc aucune hésitation, en tout cas dans la grande majorité des cas, à aller consulter un médecin. Pour les troubles en santé mentale, c’est différent. Les signes de dépression, ou d’anxiété sont moins connus, pernicieux, mais plus discrets. Clarissa Andrade pose la question : « Si l’on n’est pas capable de reconnaître les signes de dépression, est-ce que ce n’est pas en partie parce que la société n’en parle pas assez souvent? »
Manque de communication
Cette incapacité à identifier les signes, pour la psychologue, est une conséquence d’un manque de communication et d’information autour des symptômes dépressifs et des troubles mentaux en général. « Je ne dis pas que c’est comparable, mais pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu énormément de communication par rapport au vaccin, aux démarches à suivre. Le 21e siècle est celui de la dépression, or, on ne communique pas. Alors si je n’en entends parler nulle part, c’est que ça n’existe pas. Et si ça n’existe pas, c’est que c’est moi le problème », lance Clarissa Andrade avant d’ajouter : « ça contribue à l’autostigmatisation. »
Cette méconnaissance des symptômes et de la maladie pose donc problème à plusieurs niveaux. Elle peut ralentir, voire empêcher le processus de guérison, mais aussi, elle peut être stigmatisante pour les personnes souffrantes qui représentent environ 3,8 % de la population mondiale.
Cette stigmatisation s’étend à l’ensemble des enjeux de santé mentale, et concerne en particulier les troubles invalidants tels que la schizophrénie et la bipolarité. Une tendance qui serait en lien direct avec l’histoire de notre société et la manière dont les affections mentales ont été traitées par le milieu médical, comme le rappelle Clarissa Andrade. « Au 19e siècle au Manitoba, criminels et personnes souffrant de troubles en santé mentale étaient tous mis dans la même prison. »
L’effet crash d’avion
Thomas Saïas, professeur à l’Université du Québec à Montréal au département de psychologie, pense lui aussi que la relation houleuse qu’a entretenu le médical avec la santé mentale par le passé a encore des répercussions aujourd’hui. « Tout ce qui est associé au monde du psy, est considéré comme dangereux, on ne cherche pas trop à le connaître, à le comprendre. C’est de l’ordre du mystique, du différent, du caché. Et ça renvoie à des modes de discrimination qui existent depuis longtemps. À Paris vous aviez beaucoup d’asiles que l’on construisait au début du 20e siècle loin des villes de la capitale, pour mettre au loin les personnes bruyantes avec des comportements inappropriés. On veut les mettre loin, ne pas les voir. » Le professeur indique aussi que cette vision archaïque de la maladie mentale rend l’accès et la recherche de soins difficile « parce qu’on ne veut pas être associé à ça ».

Force est de constater que ces conceptions erronées à propos du schizophrène ou du bipolaire continuent d’être colportées par la culture populaire et les médias. « Parce que c’est sensationnel », lance Thomas Saïas. En effet, la symptomatologie de ces affections se prête à la création de personnages marquants et terrifiants, capables d’une grande violence imprévisible. Mais cette image-là, qui s’est infiltrée dans l’imaginaire collectif, se fait au mépris de la réalité clinique.
« Tout ce qui est associé au monde du psy, est considéré comme dangereux, on ne cherche pas trop à le connaître, à le comprendre. C’est de l’ordre du mystique, du différent, du caché. Et ça renvoie à des modes de discrimination qui existent depuis longtemps. »
Thomas Saïas
Se défaire de certaines images
« Je pense que la question de la violence est cruciale à propos des enjeux de stigmatisation. C’est en fait une forme de souffrance psychologique avant toute chose. La violence ne fait pas partie des caractéristiques de ces affections. C’est la médiatisation excessive des actes violents perpétrés par des personnes avec des troubles de santé mentale qui pose problème. » Il est intéressant ici de faire l’analogie avec les écrasements d’avion. Surmédiatisés et pourtant très rares.
« Les comportements violents ne sont pas liés à la maladie, mais une conjonction de facteurs qui peut arriver chez les gens malades ou pas. Dans une population avec un handicap psychique sévère, les taux d’homicide et de violence sont inférieurs à la population générale. Ce sont des personnes qui sont mieux connues, mieux accompagnées. »
De son côté, Clarissa Andrade corrobore : « On associe la dangerosité aux troubles en santé mentale alors que c’est plutôt l’inverse. Ces personnes-là sont plus susceptibles d’être des victimes parce qu’elles sont plus vulnérables, mais cette idée-là n’est pas une idée répandue dans notre société. »
Thomas Saïas insiste sur l’importance de promouvoir d’autres images qui correspondent davantage à la réalité d’environ 1 % de la population. « On parle quand même d’une personne sur cent, ce n’est pas rien. Et les troubles bipolaires c’est encore un autre pour cent. »
Évolution dans le milieu médical
Il est important de noter que dans le milieu médical, les choses ont beaucoup évolué. Il existe aujourd’hui des traitements qui permettent à beaucoup de personnes souffrantes d’affections mentales invalidantes de « fonctionner en société de manière très correcte au quotidien ».
Cependant, cela n’empêche pas la stigmatisation et en ce qui concerne les enjeux de santé, la société fonctionne encore à deux vitesses. « J’ai entendu beaucoup d’histoire de personnes qui, parce qu’elles suivent une psychothérapie, quelles qu’en soient les raisons, se voient immédiatement étiqueter comme fragiles, ou handicapantes pour une entreprise. On leur ferme alors des portes. »
Le professeur explique que les théories contemporaines encouragent un changement. Celles-ci indiquent que le handicap naît des interactions entre les personnes souffrantes et la société. « Si les gens autour de vous sont familiarisés avec votre affection psychique, c’est moins handicapant. On appelle ça le modèle de production sociale du handicap. C’est une approche assez progressiste, qui nécessite un réajustement de beaucoup de choses. Comme notamment l’éducation précoce à ces enjeux-là. »
Comprendre la schizophrénie et la bipolarité
La bipolarité est un trouble de l’humeur. Pour vulgariser un peu, les personnes atteintes de bipolarité passent leur vie à osciller entre des phases hautes et des phases basses. Les phases hautes sont des phases dites maniaques. Si ces épisodes peuvent parfois donner lieu à une crise délirante, ils se traduisent généralement par une grande euphorie, un surplus d’énergie et d’envies. Quant aux phases basses, il s’agit souvent de phases dépressives. À noter qu’une personne bipolaire peut passer toute sa vie sans jamais faire de crise maniaque.
La schizophrénie, en revanche, est un trouble de la personnalité, c’est une pathologie chronique complexe. Il existe plusieurs types de schizophrénie, mais elle se traduit souvent par une perception troublée de la réalité. Ces personnes ont souvent des hallucinations visuelles ou auditives ou encore des idées délirantes. Elle peut s’accompagner de crises de psychose qui se traduisent par une perte de contact avec la réalité. La schizophrénie n’est pas un dédoublement de la personnalité.
Initiative de journalisme local – Réseau.Presse – La Liberté