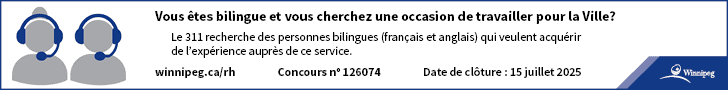Alors que de son côté l’Europe tire la sonnette d’alarme, que risque le Canada au regard de cette nouvelle relation diplomatique? Thierry Lapointe, professeur spécialiste en politique internationale à l’Université de Saint-Boniface, répond à La Liberté.
Le 12 février dernier, une longue entrevue téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine avait mis fin à des années d’efforts pour isoler les Russes de la scène internationale par l’administration Biden.
Une semaine plus tard, le secrétaire d’État américain et le ministre russe des Affaires étrangères se rencontraient à Riyad pour reprendre leurs relations diplomatiques et commerciales.
Plus tard, le 28 février, lors d’une joute verbale inédite dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, le président des États-Unis avait lancé dans le feu de l’action : « Poutine et moi, on en a bavé ».
Une phrase loin d’être anodine qui semble avoir définitivement placé le président aux côtés de son homologue russe.
La « remise en cause de l’ordre mondial »
Sur la scène internationale, la principale menace du rapprochement entre les deux dirigeants se concentre d’abord sur les questions de souveraineté. « On assiste à la remise en cause des fondements de l’ordre mondial actuel », observe Thierry Lapointe. Pour le professeur de sciences politiques, la relation Trump-Poutine semble « indiquer que les revendications en termes de sphères d’influence et d’acquisition territoriale par la force peuvent être considérées comme légitime ».
En suivant cette logique, Donald Trump pourrait considérer qu’il est normal pour une puissance telle que la Russie de chercher à étendre sa zone d’influence en dépit de la souveraineté de ses voisins. « Ça suppose alors que les États-Unis auraient carte blanche dans une prétendue acquisition du Canada, du Panama ou du Groenland », souligne Thierry Lapointe.
« Il y a des affinités idéologiques et une lecture commune du fonctionnement des relations internationales qui s’inspirent beaucoup des dynamiques du 19e siècle où le droit international était celui du plus fort », constate le spécialiste. Pour le Canada, cette situation peut devenir très préoccupante. « Si ce rapprochement se concrétise, on pourrait assister à l’implosion du traité de l’Atlantique Nord, dont le Canada est l’un des membres fondateurs, ou encore une mise en péril du NORAD (le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord) ».
Un scénario tout aussi inquiétant pour les autres pays dont la souveraineté est souvent menacée, comme Taiwan avec la Chine par exemple.
Ingérence et désinformation
En septembre 2024, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, déclarait ceci : « les renseignements canadiens ont montré que depuis l’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, RT [le média russe Russia Today] s’est activement engagé dans les efforts mondiaux de désinformation et d’influence de la Russie en agissant comme un prolongement des services de renseignement russes, en s’appuyant sur des opérations de piratage, psychologiques et d’information soutenues par l’État, influence et acquisitions militaires. ».
Alors que les campagnes de désinformations russes menacent déjà la majorité des puissances occidentales, notamment lors de campagnes électorales, le rapprochement Trump-Poutine pourrait bien accélérer ce phénomène au Canada.
En effet, depuis plusieurs années, des commentateurs politiques anonymes, appelés « trolls russes », ont pour objectif de manipuler l’opinion publique internationale. Regroupées dans des « usines à trolls », ces brigades d’anonymes utilisent des faux comptes et des bots pour promouvoir la propagande pro-russe sur les réseaux sociaux et les forums en ligne.
« Le financement de ces activités de hacking par la Russie permet de déstabiliser les pays en remettant en question les croyances, et donc, en mettant en péril la confiance des citoyens envers les médias et leurs institutions », explique-t-il.
Alors que les médias sociaux fonctionnent avec des algorithmes personnalisés, réfléchis sur une base de rentabilité économique, ces derniers peuvent participer à la radicalisation des idées. Ainsi, à l’approche de potentielles élections canadiennes, « le danger pour le pays réside dans cette radicalisation instituée par les médias sociaux et cela pourrait le faire sombrer dans une situation dramatique de polarisation des débats et des idées ».
Mais au-delà des campagnes de désinformation russes, rappelons que certains marqueurs d’influence états-uniens semblent tout aussi inquiétants.
Alors qu’Elon Musk, aujourd’hui le bras droit de Donald Trump, détient le réseau social X, « des millions de canadiens qui s’informent sur cette plateforme se retrouvent face à une désinformation généralisée », et toute aussi dangereuse.