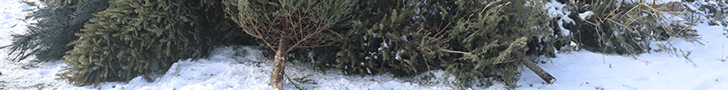Dans l’espoir de contrôler enfin les algues bleu-vert qui affectent le lac Killarney, le comité d’action du lac Killarney met en œuvre cette année un projet pilote utilisant des nanobulles d’oxygène. Un regard sur cette technologie.
Les algues bleu-vert sont un fléau bien connu des amateurs de lacs canadiens. À Killarney Turtle Mountain, une municipalité à près de 250 km au sud-ouest de Winnipeg, elles affectent depuis plusieurs années les résidents et les touristes pendant les mois les plus chauds, provoquant même parfois la fermeture de la plage du lac Killarney.
Bien que les proliférations d’algues aient auparavant été traitées chimiquement avec du sulfate de cuivre, ce produit a depuis été rendu illégal au Canada, obligeant la municipalité à chercher des alternatives.
C’est pourquoi, il y a quelques années, le comité d’action du lac Killarney (KLAC), un groupe de résidents désireux de trouver des solutions pour entretenir le lac, s’est réuni pour trouver des solutions. Leur dernière tentative : la technologie des nanobulles.
Qu’est-ce que les algues bleu-vert?
Mais d’abord, un peu de contexte. Les algues bleu-vert, malgré leur surnom, sont en fait un type de bactéries, explique le biologiste Fernand Saurette. « Ce sont réellement des bactéries photosynthétiques. Elles existent depuis 3 milliards d’années et c’étaient les premiers organismes à convertir le dioxyde de carbone en oxygène. »
Si ces cyanobactéries peuvent contribuer à un écosystème sain, elles deviennent un problème dans les environnements riches en phosphore. Comme elles se développent beaucoup plus rapidement en présence de ce minéral, elles se multiplient à l’excès, créant d’épaisses couvertures de fleurs d’eau vertes.
Lorsque ces fleurs d’eau apparaissent en masse, elles bloquent la lumière du soleil, empêchant le processus de photosynthèse et d’oxygénation de l’eau. Les bactéries commencent à mourir et à se décomposer dans le lac, consommant davantage d’oxygène et asphyxiant le cours d’eau.
Non seulement cette perte d’oxygène peut affecter les populations de poissons, mais ce problème de prolifération rend également les cyanobactéries plus susceptibles de produire des cyanotoxines. Ce sont ces toxines qui rendent les algues bleu-vert dangereuses pour la santé des humains et des animaux domestiques.
« La source du problème, c’est que ce lac est entouré de terrains agricoles et probablement de chalets aussi, dit Fernand Saurette. Ça fait en sorte que toutes les eaux environnantes, par le ruissellement, vont s’accumuler dans ce lac. »
Le ruissellement des produits chimiques utilisés par les agriculteurs, les égouts pluviaux et les excréments des animaux sauvages s’accumulent tous dans le lac, sans qu’aucune issue ne permette à l’eau d’être débarrassée des minéraux en excès. Au fil du temps, les sédiments de phosphore se sont accumulés au fond du lac, créant un environnement parfait pour la prolifération des cyanobactéries.
En outre, les autres bactéries qui décomposent le phosphore et les autres sédiments au fond du lac ont besoin d’oxygène pour survivre. Mais lorsque les parties les plus profondes du lac manquent d’oxygène, ces organismes cessent de fonctionner.
Avec le temps, cela aggrave le problème et crée un déséquilibre qui permet aux cyanobactéries de prospérer tandis que les autres composantes de l’écosystème meurent lentement.
Des bulles microscopiques

Après avoir étudié les solutions possibles, le comité d’action du lac Killarney est arrivé à la conclusion sui- vante : en réoxygénant le lac à différents niveaux de profondeur, les organismes responsables pour la désintégration des sédiments pourront fonctionner normalement et débarrasser le lac de l’excès de phosphore.
« Nous essayons d’enrichir le lac en oxygène, explique Shane Warnez, responsable principal du projet pilote des nanobulles. On les appelle nanobulles parce qu’elles sont extrêmement petites ; en fait, elles sont presque microscopiques. On ne peut pas les voir dans l’eau. »
« Elles sont également neutres sur le plan de la flottabilité, ce qui signifie qu’elles ne flottent pas vers le haut, mais qu’elles se répandent dans tout le lac, incluant dans le haut, le milieu et le bas. »
Non seulement le contact avec les nanobulles tue les cyanobactéries, aidant à décomposer certaines des proliférations d’algues et des nutriments présents dans l’eau dont se nourrissent les cyanobactéries, mais il contribue aussi à redonner de l’oxygène à d’autres organismes qui débarrassent le lac d’une population excessive de cyanobactéries, les décomposent et décomposent les sédiments en excès dans le lac.
Autrement dit, réinsérer de l’oxygène dans le lac rétablit une partie de l’équilibre nécessaire pour empêcher la prolifération des cyanobactéries.
Une nouvelle solution
Ces dernières années, le KLAC avait utilisé des microbulles, une méthode similaire pour débarrasser le lac des algues bleues. La principale différence se trouvait dans la taille et la composition des bulles : les conduits d’air poussaient de l’air normal à travers le lac. Cependant, comme les bulles flottaient à la surface, leur temps d’exposition et leur capacité à enrichir le lac en oxygène étaient limitées.
Bien que l’équipe ait réussi à éradiquer un type de cyanobactéries du lac à l’aide des microbulles, elle a continué à chercher une solution moins coûteuse qui permettrait de contrôler les deux autres types de cyanobactéries présents dans le lac.
« Après environ un an de recherches et de discussions avec divers consultants, ingénieurs en environnement, fabricants et autres autorités, nous sommes parvenus à ce projet pilote parce qu’il répondait le mieux à nos critères, explique Shane Warnez.
Grâce à ses recherches, le KLAC a pu conclure un accord avec SWAT Water Technology, un fabricant de machines à nanobulles basé à Calgary. Une nouvelle entreprise, elle a accepté de prêter gratuitement les machines au KLAC, permettant d’élaborer ce projet pilote de façon plutôt économique.
« Les seules choses supplémentaires que nous devions payer étaient l’installation, qui était d’environ 4000 $ ; l’analyse de l’eau, qui sera d’environ 3 000 $ ; et ensuite l’électricité, qui est d’environ 2 500 $. »
Le projet pilote se déroulera jusqu’à la fin de l’été, et l’équipe est optimiste quant au fait qu’il s’agit d’une bonne solution à long terme.
« La plage était pleine ici quand j’étais enfant, ajoute Shane Warnez. Nous avons encore une bonne industrie touristique. Nous avons deux grands terrains de camping. Ils sont généralement pleins, mais la plage ne l’est plus autant qu’avant. Cela va donc vraiment, vraiment aider au développement économique de la communauté. »
Initiative de journalisme local – Réseau.Presse – La Liberté