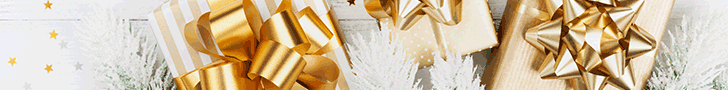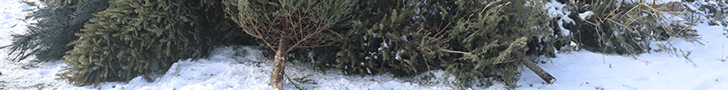Argentin de nationalité, il fut le premier souverain pontife originaire d’Amérique latine. Élu le 13 mars 2013, après la renonciation de Benoît XVI, ses 12 années de pontificat ont été marquées par son ouverture et des idées nouvelles. Quel souvenir laisse-t-il dans les mémoires collectives?
Accessible et proche du peuple, c’est sans doute l’image que beaucoup retiennent de l’ancien chef de l’Église. « C’était quelqu’un d’humble, ouvert et avec un bon sens de l’humour », confie Emma Anderson, professeure d’études religieuses à l’Université d’Ottawa.

Monseigneur LeGatt, archevêque de l’archidiocèse de Saint-Boniface, le décrit comme un homme à l’écoute de son prochain. Il se souvient notamment d’un voyage réalisé au Vatican en 2017 en compagnie des évêques de l’Ouest du Canada. Les hommes d’église avaient alors eu le privilège de converser environ 2h30 avec lui sur des sujets d’actualité et propres au pays.
« Il posait par exemple des questions sur la relation entre les peuples autochtones et l’Église. Nous avons aussi été questionnés sur l’état du catholicisme dans ce coin du monde. Il voulait vraiment en apprendre plus et nous nous sentions libres de l’approcher comme un frère d’évêque. »
À l’annonce de sa mort, le paroissien Guy Ferraton a eu la sensation de « perdre un bon ami ».
Sur ses prises de position notables, le pape François s’était distingué de ses prédécesseurs notamment sur la question de l’environnement. Il en a fait une préoccupation urgente et sérieuse en « considérant la dégradation de notre planète comme un péché », rapporte la professeure.
Le Saint-Père avait d’ailleurs mis en avant son combat écologique au cœur d’un de ses textes intitulé Laudato Si’(2015), où la Terre est désignée comme notre « maison commune » à sauvegarder.

Le pontife argentin a par ailleurs adopté une posture plus ouverte envers les divorcés-remariés dans la vie de l’Église sans pour autant en changer les règles. Il préfère une approche personnalisée en ouvrant la possibilité, selon les cas, de permettre aux personnes divorcées et remariées civilement d’accéder aux sacrements.
« Il s’est demandé pourquoi les personnes divorcées puis remariées ne pourraient pas avoir accès aux sacrements, surtout lorsque ce ne sont pas elles qui sont à l’origine de la rupture ou qui ont commis une faute. Dans cette perspective, il estime qu’il n’est pas juste de les exclure de la vie sacramentelle de l’Église », explique Emma Anderson.
Toutefois, si le pontificat du pape François a notamment été marqué par une avancée dans la reconnaissance et la lutte contre les abus sexuels sur mineurs au sein de l’Église, ce travail reste encore inachevé pour la professeure en études religieuses.
« Certes, il a fait beaucoup plus que les autres papes avant lui. Mais ce n’est pas suffisant. Il reste encore beaucoup de travail pour que l’Église devienne un lieu plus sûr », déclare Emma Anderson.
Une visite historique
Le pape s’était rendu en personne sur le sol canadien pendant près d’une semaine en juillet 2022. Il avait alors présenté ses excuses à la communauté autochtone dans le rôle qu’a joué l’Église dans les pensionnats. Une visite historique marquée dans la mémoire des Canadiens et Canadiennes.
« Jusqu’à 2022, nous n’avons pas eu d’excuse formelle de la papauté », relève Emma Anderson, signifiant ainsi l’importance de cette démarche de l’ancien chef de l’Église.
« Il n’a pas simplement fait un petit saut à Toronto mais a traversé presque le pays entier alors qu’il n’était pas en très bonne santé. Il a montré qu’il avait compris le problème et qu’il s’agit d’un sujet lourd et sensible. »
Pour Monseigneur LeGatt, ce voyage pénitentiel du Saint-Père fut aussi une façon de signifier aux évêques, aux prêtres et aux personnes laïques qu’il leur incombait désormais de « poursuivre ce chemin vers la réconciliation ».
Bien que le Pape François ait tenté d’unifier l’Église par son ouverture, certaines prises de position ont contribué à la diviser, suscitant une opposition de la part des conservateurs. Pour la professeure Emma Anderson, cette opposition explique pourquoi le pape n’a pas opéré de changements plus formels sur des sujets sensibles, comme le mariage homosexuel.
Et ces divisions ont notamment été remarquées la veille du décès du pontife. En effet, le dimanche 20 avril le pape François a reçu au Vatican J.D. Vance, l’actuel vice-président des États-Unis.
Au cours de leur échange, ce sont deux visions différentes de la religion catholique qui se sont affrontées, avec une approche plus miséricordieuse et tournée vers l’accueil des immigrants du côté du pontife, et une autre plus conservatrice pour ce qui est du politique américain. « Le pape a réaffirmé son soutien auprès des pauvres, des immigrants et des réfugiés.
Avec cette rencontre nous avons vraiment les deux visages possibles de l’Église catholique dans le futur. »
Le futur visage de l’Église
Justement, quelle direction va prendre l’Église? Y aura-t-il une continuité du pape François, ou bien un retour à une vision plus conservatrice est-il possible? Le nom retenu par le Collège des cardinaux à l’issue du conclave sera déterminant.
Emma Anderson mise en premier lieu sur le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, en l’inscrivant dans la lignée du défunt pape avec une tendance libérale. « Il partage les mêmes valeurs que le pape François. »
La professeure voit également un bon candidat potentiel en la personne de Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican et cardinal italien, avec un profil davantage « modéré et centriste. Il peut être un bon choix pour unifier les libéraux et les conservateurs. »
De son côté, le paroissien Guy Ferraton aimerait voir « un pape de couleur » venu d’Afrique mais souhaite avant tout que « le meilleur choix possible » l’emporte.

La paroissienne Brenda Arakaza, quant à elle, penche pour une continuité du dernier pontificat avec un pape axé sur le dialogue et l’ouverture. « C’est compliqué d’être tous ensemble mais c’est important de s’écouter même si l’on ne partage pas les mêmes valeurs. »
D’après Monseigneur LeGatt, « l’unité dans la diversité » au sein de l’Église catholique dépendra de la volonté de chacun à « prendre à cœur ou non son message qui est de s’écouter les uns les autres. »
Une élection dans le plus grand des secrets
Si les funérailles du pape se sont déroulées le samedi 26 avril dernier, au cours desquelles une cinquantaine de chefs d’États ont fait le déplacement, la prochaine grande étape reste celle du conclave, dont le début est fixé au 7 mai.
Généralement organisé dans les 15 à 20 jours suivant le décès du pape, ce terme désigne à la fois le lieu et l’assemblée au cours de laquelle les cardinaux du monde entier se réunissent pour élire le prochain chef de l’Église catholique.
En tout, 135 cardinaux de moins de 80 ans sont coupés du monde et isolés dans la chapelle Sixtine. Ils n’en sortent pas tant qu’ils ne se sont pas accordés sur un nom, c’est-à-dire tant qu’aucun candidat n’a recueilli au moins les deux tiers des voix.
Il faut également que le cardinal désigné accepte officiellement son élection avant que l’annonce soit faite.
Pendant ce huis-clos, tous les yeux seront rivés sur la cheminée de la chapelle Sixtine, guettant ainsi que la traditionnelle fumée passe du noir au blanc pour signifier au monde entier qu’un nouveau Saint-Père est élu.
Ce processus secret est d’ailleurs mis en scène dans le film Conclave (2024), réalisé par Edward Berger, dont le visionnage sur la plateforme Prime Vidéo a été multiplié par quatre depuis le décès du pape François.