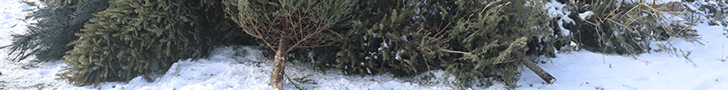Chronique – Roger TURENNE
Voilà une formulation malheureusement ambiguë qui soulève toutes sortes de possibilités, et qui porte à réfléchir sur l’objectif de cet exercice.
C’est quoi, au juste, un « Manitoba bilingue »? Il y a deux réponses possibles à cette question. Il y a d’abord le cadre constitutionnel et législatif qui définit les responsabilités des gouvernements et les droits des citoyens. Ensuite il y a le vécu de ces citoyens.
En ce qui concerne le Manitoba, le cadre législatif est vaste. L’article 23 de la Loi sur le Manitoba, entériné dans la constitution, est la clé de voûte. L’obligation de légiférer dans les deux langues officielles et de donner accès aux tribunaux dans les deux langues, fait du Manitoba une province officiellement bilingue. Seulement trois provinces au Canada sont assujetties à cette obligation : le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et, à son corps défendant, le Québec.
Il y a beaucoup plus. Si l’article 23 de la Charte des droits et libertés, qui garantit l’accès à l’éducation en français et à la gestion scolaire, s’applique à toutes les provinces, la Loi sur les écoles publiques du Manitoba va plus loin que le minimum requis par la Charte.
La Loi sur l’université de Saint-Boniface s’ajoute à la Loi sur les écoles publiques.
La Loi sur le Centre culturel franco-manitobain désigne celui-ci comme une société de la couronne avec un mandat de promouvoir la culture française.
Plusieurs lois imposent des obligations et des droits en matière de services gouvernementaux.
Il y a la Loi sur les centres de services bilingues; la Loi sur les offices régionaux de la santé – Règlement sur les services en français; les règlements sur les services en français de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille; la Partie 9 de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg qui impose à cette ville une obligation en matière de services en français.
Enfin, une des plus importantes, la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine. Cette dernière fournit un cadre législatif qui permettrait de corriger les lacunes des autres lois et de mettre sur pied, par voie de règlement, tous les appuis ou nouveaux services que l’on pourrait juger nécessaires.
Voilà tout un écosystème d’obligations constitutionnelles et de lois et règlements qui n’a d’égal nulle part ailleurs au Canada à l’exception du Nouveau-Brunswick, et qui font du Manitoba, incontestablement, une province officiellement bilingue. Le Nouveau-Brunswick se targue d’être la seule province canadienne officiellement bilingue. Or la seule différence entre le Nouveau-Brunswick et le Manitoba est le fait que les services en français sont garantis par la Constitution pour le Nouveau-Brunswick et par la législation provinciale au Manitoba. Cette distinction n’a aucun effet sur le quotidien et n’a pas aidé les Acadiens sous la gouverne d’un premier ministre hostile comme Blain Higgs. Elle n’a pas, non plus, nuit aux Manitobains sous celle des premiers ministres sympathiques comme Gary Filmon, Greg Selinger ou Wab Kinew.
Je trouve donc la formulation de la question 3 sur le sondage de la province trompeuse et malheureuse. Elle se lit comme suit : « Aujourd’hui, le Manitoba n’est toujours pas vu comme une province bilingue. Selon vous, quelles sont les lacunes? » Cela évoque la possibilité qu’une nouvelle loi, voire même un amendement constitutionnel, pourrait combler ces lacunes. Cette hypothèse a parfois été avancée, notamment dans des réflexions constructives provenant de l’éditorialiste de La Liberté, Michel Lagacé, et du président de la SFM, Derrek Bentley, mais elle circule aussi dans les médias sociaux, où elle est parfois reprise par des individus hostiles au bilinguisme. Il faudrait à tout prix écarter cette notion, sans quoi nous pourrions nous retrouver devant une réaction hostile d’une partie non négligeable de la population. La question aurait plutôt dû se lire comme suit : « Le Manitoba est une province officiellement bilingue. Selon vous, que faudrait-il pour traduire cette réalité dans votre quotidien? »
Les réponses au sondage seront nombreuses (et toutes très prévisibles), mais il existe un moyen pour combler les lacunes identifiées dans le cadre législatif actuel, principalement la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine. La question se pose alors : pourquoi cette loi n’a-t-elle pas été utilisée à son plein potentiel pour s’attaquer aux problèmes connus depuis longtemps?
Cette loi n’est pas parfaite et il y aurait lieu d’y apporter quelques amendements pour modifier le cadre administratif dysfonctionnel qui existe actuellement. Or la SFM vient justement d’annoncer qu’elle a proposé au ministre Glen Simard un projet d’amendement, sans en préciser le contenu. Espérons que cela donne de bons résultats. Espérons également que l’on profite de l’occasion pour clarifier les objectifs de l’exercice en cours concernant un Manitoba “vraiment bilingue “.