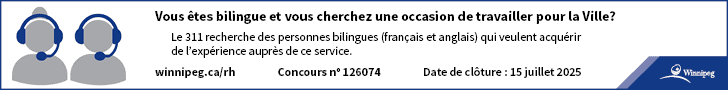Par Lorène Lailler
Je descends l’escalier maladroitement. Mes yeux sont encore mi-clos et mes joues témoignent de leur éternelle histoire d’amour avec les draps! Un pas devant l’autre, le corps tout entier tiré par une odeur chaude et sucrée.
J’ouvre la porte de la cuisine, Mamie est là entourée de son tablier qui a bien vécu. Un plat dans le four, la poêle qui crépite, la danse des spatules, le linge déjà lavé, étendu, presque sec, la cocotte qui fume à la fenêtre, et sur la table mon bol m’attend. Mais l’odeur me tire toujours.
Quand soudain, les yeux au niveau du comptoir, je la vois : la grosse casserole métallique encore fumante. Je regarde ma grand-mère avec des yeux qui espèrent. Comme si elle pouvait me dire non! Elle pousse mon bol, pose la casserole devant ma chaise avec une petite cuillère. Je rentre la tête dedans, je suis enveloppée de cette douce odeur. Je gratte frénétiquement le fond pour décoller le grillé sucré, le crémeux oublié… je m’assure de ne rien laisser.
Pour moi, l’amour inconditionnel c’est ma grand-mère et sa crème à la vanille.
Héritage
C’est l’automne, la demeure est froide et humide. Le docteur a été appelé. Ma Marcelle est allongée dans notre lit. De petites gouttes perlent sur son front, je les éponge doucement avec un linge. Elle ne veut pas d’enfants. J’en veux moi. Comme si c’était nous qui choisissions! Le Bon Dieu nous en envoie un. L’enfant est en avance, très en avance.
Le docteur est arrivé. J’embrasse mon épouse sur le front et sors de la chambre. Je tire ma montre à gousset de ma poche. Le temps ralentit, s’étire, s’arrête puis je peux finalement retourner auprès d’elle. Le docteur me dit :
– Une petite fille, Monsieur Monge, bien trop fragile, elle ne survivra pas.
Mais il se trompe. Je la trouve quelques jours plus tard, dans une petite boîte à chaussures au fond de la maison où il l’a laissée après l’accouchement. Encore en vie.
* * *
C’est l’automne, le foyer est chaud et trempé. Je suis allongée la tête en bas. J’entends des voix lointaines. Ça brasse, ça tire, ça pousse. Je vois la lumière, j’ai froid, je ne sais pas si je crie. Les voix sont plus claires maintenant. J’ai moins froid, je suis entourée de choses droites et dures. La lumière diminue, les voix n’existent plus. Je suis de nouveau dans le noir, il n’y a plus d’eau, ni de chaleur, ni de cœur qui bat. Tout est froid et humide. J’ai peur. J’ai mal. J’ai soif. Lumière… noir… lumière… noir… lumière. La chaleur m’envahit, quelque chose coule dans ma gorge, c’est bon. J’ai chaud, je suis serrée doucement, je suis bercée délicatement. La voix est protectrice. Je vis.
* * *
C’est l’automne, la clinique est froide et déserte. La manipulatrice en radiologie a été appelée, je suis allongée sur le lit coulissant. J’entre lentement dans l’IRM. Mon cœur s’accélère, ma respiration est saccadée. Je crie. Je demande à sortir. Je ne peux pas être coincée dans cette machine pendant 20 minutes. Pas le choix. Le lit coulisse à nouveau, mon cœur s’accélère, je me force à respirer régulièrement. La panique m’envahit, je suis prisonnière. J’imagine une prairie verte immense. La panique est à peine contrôlable. Je me demande pourquoi cette angoisse. Restée coincée à ma naissance? Peur transmise par ma mère? Et soudain, l’histoire de la naissance de ma grand-mère maternelle me revient en mémoire. Une information apprise plusieurs années auparavant, oubliée, bloquée, enfouie depuis. Je combats la panique pour qu’elle ne me consume pas. Enfin, je peux sortir. Je revis.