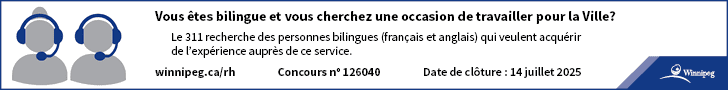À chaque génération d’historiens son lot de sujets d’études, reflets des questionnements de la société à une époque donnée. Les recherches se succèdent, ajoutant de nouvelles pierres à l’édifice, et proposent au gré des redécouvertes de nouvelles perspectives sur le passé. Analyse avec quatre historiens.
Lucas Pilleri (Francopresse)
« Plus on avance dans le temps, plus on se pose de questions », avance Serge Miville, professeur à l’Université Laurentienne depuis 2015. Les connaissances accumulées au fil des générations amènent à de nouvelles interrogations. « Il faut une génération montante d’étudiants qui cherche à étudier les nouveaux sujets, à ouvrir de nouveaux chantiers », ponctue-t-il.
Outre l’immigration, la question des femmes tient une place de choix parmi les sujets d’avenir. « L’une des plus grandes lacunes en Ontario français, c’est le manque d’études sur les femmes franco-ontariennes, notamment parce que la plupart des historiens sont des hommes », estime Serge Miville, également titulaire de la Chaire de recherche en histoire de l’Ontario français depuis 2016.
À Edmonton, l’historienne Valérie Lapointe-Gagnon apporte une dimension genrée à son travail en étudiant des figures historiques telles que Gertrude Laing, une francophile de Calgary engagée pour la dualité linguistique et culturelle. Par ailleurs, la professeure à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta souligne la montée des enjeux autochtones en lien avec la francophonie.
Des recherches à poursuivre
Le travail des historiens actuels vient compléter celui de leurs prédécesseurs. « Gaétan Gervais a établi la trame de l’Ontario français à partir de la Nouvelle-France, illustre Martin Pâquet, professeur d’histoire à l’Université Laval. Il fallait que ce travail de base soit fait. C’est comme une cathédrale : chaque bloc s’ajoute à l’édifice. Il y a toujours de nouvelles réflexions à apporter. »
Représentante de la nouvelle génération, Valérie Lapointe-Gagnon partage l’avis de son maître d’études : « La jeune génération travaille avec les concepts qui ont été développés par les défricheurs. On poursuit la réflexion avec le socle déjà présent. » Par exemple, le concept de complétude institutionnelle développé par Raymond Breton dans les années 1960 a été revisité par Joseph Yvon Thériault en 2014, ou encore par Linda Cardinal et Rémi Léger en 2017.
Surtout, bénéficiant d’une relecture, les relations entre le Québec et la francophonie canadienne promettent de beaux horizons d’étude. « Cette génération émergente de milléniaux qui commencent à devenir professeurs n’a pas connu les États généraux du Canada français [de 1966 à 1969], ni les référendums de 1980 et 1995. Ils n’ont pas le même rapport que leurs parents et grands-parents avec le Québec. Tout ça permet de changer la façon de réfléchir à ces questions. »
Preuve en est le regard neuf de Valérie Lapointe-Gagnon sur le sujet, professeure depuis trois ans : « J’ai beaucoup d’intérêt pour cette solidarité qu’on sent entre les Québécois et les communautés minoritaires. Elle n’a jamais vraiment disparu malgré les États généraux. »
La jeune historienne repense aussi la réconciliation linguistique avec sa thèse sur la Commission royale d’enquête des années 1960. Dans Panser le Canada, elle étudie cette tentative de « compromis constitutionnel pour rééquilibrer les pouvoirs entre anglophones et francophones », dont la Loi sur les langues officielles de 1969 découle.
La question identitaire revient aussi sur le devant de la scène, un thème qu’affectionne Serge Miville. « Comment et pourquoi la communauté franco-ontarienne cherche à se structurer en petite société autonome ? Quand on vit en situation minoritaire, qu’est-ce qui nous distingue, légitime notre existence et notre perpétuation ? » Ces interrogations semblent avoir de belles heures devant elles. « La question identitaire risque de ne jamais être complètement écoulée », prédit l’universitaire.
Valérie Lapointe-Gagnon constate elle aussi ce regain d’intérêt parmi ses étudiants : « On a une génération qui est en train de se réapproprier la langue de ses ancêtres, perdue à cause de l’assimilation et du manque d’accès à l’éducation en français. Ils veulent savoir d’où ils viennent, comment la langue s’est perdue. »
« Toute histoire est contemporaine »
« On est conscients d’être le produit de nos époques », soulève Serge Miville. Pas étonnant, donc, qu’avec le recul des redécouvertes surviennent. « Je tendais à réfléchir autrement sur les États généraux qui, finalement, ne représentent pas une fracture si immense », juge-t-il.
Autre exemple avec l’Église qui subit un regard très critique dans les années 1960-1970, mais avec qui la nouvelle génération entretient un rapport moins viscéral. « Le regard est plus détaché, plus neutre, moins marqué par les passions », observe Martin Pâquet qui, à 55 ans, a formé une dizaine de jeunes docteurs.
Pour le titulaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN), les historiens cherchent surtout à répondre aux questions de leur temps. « Les grandes avancées en histoire viennent de la rencontre entre les intérêts de la société et les propres inclinaisons des historiens. Toute histoire est contemporaine, disait Benedetto Croce [un historien italien de la fin du 19e et du début du 20e siècle]. »
Du politique au social
Dès les années 1960, les milieux érudits passent de l’histoire politique à l’histoire sociale, qui traite désormais des groupes en s’appuyant sur la sociologie. Jusque-là, l’histoire était restée surtout politique, « très axée sur les actions des élites, un petit groupe d’hommes blancs », relève Joel Belliveau, professeur à l’Université Laurentienne depuis 2009.
Contre l’ancien récit national se développe alors une histoire en marge des mouvements d’affirmation des minorités culturelles. « On a commencé à s’intéresser aux groupes marginalisés qui ne sont pas inclus dans la grande Histoire », relate l’Acadien.
Dans les années 1960-1970, beaucoup de postes de professeurs sont créés. « Ces historiens, comme Gaétan Gervais, répondaient à une demande sociale : les communautés cherchaient à comprendre leur histoire pour pouvoir, bien souvent, s’engager politiquement », décrypte Martin Pâquet. Ainsi sont fondées l’Université Laurentienne en 1960 et l’Université de Moncton en 1963.
Si l’histoire sociale a imprégné les milieux universitaires de cette époque, la question politique n’a pas dit son dernier mot. « Il y a un certain ressac, une résurgence de l’histoire intellectuelle, culturelle et religieuse. Car certains critiquent le poids du social dans la recherche et affirment que le projet national a été oublié », rapporte Joel Belliveau.
Nostalgie ou aller-retour inévitable de l’histoire ? La nouvelle génération ne manquera pas de matière.