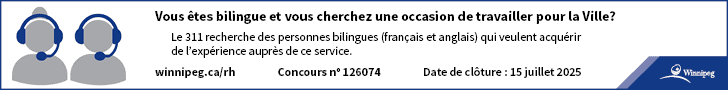Au cours de la campagne électorale fédérale de 2021, plusieurs partis politiques se sont engagés à introduire une législation sur la rémunération des journalistes.
Par Paul Deegan, président et directeur général de Médias d’Info Canada et Maria Saras‑Voutsinas, directrice générale du Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada.
Pourquoi une telle législation est-elle nécessaire ?
Tout d’abord, le besoin de nouvelles locales fortes et indépendantes n’a jamais été aussi criant. Celles-ci permettent aux communautés de rester connectées et informées sur les questions qui les touchent directement. Couvrir les mairies, les assemblées législatives provinciales et territoriales, et les tribunaux et demander des comptes aux parlementaires est vital pour notre démocratie. Nous avons demandé à Pollara, un important cabinet de recherche, de poser une question aux Canadiens. Quatre-vingt-dix pour cent des répondants ont dit qu’ils croyaient qu’il était important que les médias locaux survivent. Et pour que ces médias survivent, ils doivent être commercialement viables.
Deuxièmement, il existe un important déséquilibre de pouvoir entre les géants de la technologie et les organismes de presse canadiens. Pour mettre cela en perspective, la capitalisation boursière de Google est d’environ 2,3 billions de dollars ; celle de Meta est de plus d’un demi-billion. Ensemble, ces chiffres sont supérieurs au PIB du Canada, du Brésil, de l’Italie ou de l’Inde. Sur une base combinée, la part de ces entreprises dans les revenus publicitaires en ligne s’élève à plus de 80 %. Et la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation.
Troisièmement, dans la perspective d’une législation canadienne, Google et Meta ont négocié des accords de licence de contenu avec une douzaine d’éditeurs de presse, dont de grands acteurs comme le Globe and Mail et le Toronto Star. Ces éditeurs devraient être rémunérés pour leur contenu. Mais nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation où Google et Meta choisissent les gagnants et les perdants parmi les éditeurs de presse canadiens. Et ce n’est pas juste, surtout pour les nombreux petits éditeurs qui ont été laissés pour compte.
En avril, Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a présenté le projet de loi C‑18, la Loi sur les nouvelles en ligne. Selon ce même sondage Pollara, 80 % des Canadiens sont favorables à ce que le Parlement adopte une loi qui permettrait aux petits médias de négocier collectivement avec les géants du web. Nos organisations, qui représentent des centaines de titres de presse de confiance dans chaque province et territoire, soutiennent cette législation pour trois raisons.
Premièrement, elle nous permet en tant qu’éditeurs de nous réunir et de négocier collectivement. Actuellement, la Loi sur la concurrence nous empêche de former un collectif. Compte tenu de l’écrasant déséquilibre des forces, nous serons dans une position de négociation plus forte si nous nous unissons.
Deuxièmement, il comprend un mécanisme d’exécution. L’arbitrage de l’offre finale de type baseball garantit que les parties présentent leur meilleure offre et que l’arbitre choisit l’une ou l’autre. La menace de l’arbitrage incite les deux parties à parvenir par elles-mêmes à un règlement équitable.
Troisièmement, une législation similaire en Australie fonctionne. Selon Rod Sims, l’ancien président de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, les montants versés aux organismes de presse s’élevaient à plus de 200 millions de dollars. Ce qui est plus important que le montant, c’est de savoir qui a conclu les accords de licence de contenu. Country Press Australia, une affiliation de 160 petits journaux régionaux, a pu conclure des accords avec Google et Meta.
Plus récemment, un groupe de 24 petits éditeurs australiens a conclu un accord avec Google. Nous pensons que Google, et c’est tout à son honneur, a signé un accord de licence de contenu avec chaque éditeur australien éligible.
Bill Grueskin, professeur de pratique professionnelle à l’école supérieure de journalisme de Columbia, a écrit dans un mémoire pour le Judith Neilson Institute : « Monica Attard, professeur de journalisme à Sydney, dit qu’elle n’arrive pas à persuader la plupart des étudiants d’accepter des stages de nos jours parce qu’il est si facile pour eux de décrocher des emplois à temps plein – et elle suppose que le Code en est en grande partie responsable : ‘Je jure devant Dieu que je n’ai pas vu cela depuis 20 ans’. »
Si les éditeurs tirent manifestement des avantages de la négociation collective, la question qui se pose est la suivante : comment les membres de chaque collectif doivent-ils s’organiser de manière à être inclusifs, équitables et transparents pour tous leurs membres ?
Par principe, Médias d’Info Canada et le Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada croient que les petits et grands éditeurs devraient bénéficier également de tout règlement – en fonction de leur investissement proportionnel dans les employés de la salle de presse. En d’autres termes, tout règlement découlant de la négociation collective serait partagé entre les éditeurs au prorata – en fonction du total de la rémunération et des salaires versés aux employés admissibles de la salle de presse – moins les dépenses associées à cette négociation collective.
Le projet de loi C-18 s’appuie sur le succès du News Media Bargaining Code de l’Australie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution miracle, il permet aux lecteurs de bénéficier d’un contenu journalistique canadien fiable et de grande qualité grâce à un plus grand nombre d’accords de licence, ce qui permettra à un plus grand nombre d’éditeurs de réinvestir dans leur salle de presse et dans la transformation numérique de leur entreprise.