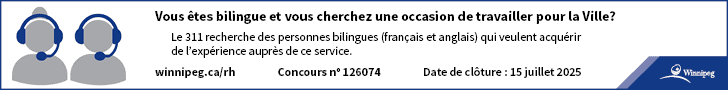FRANCOPRESSE – Il y a beaucoup de fierté à être la première personne de sa famille à aller au collège ou à l’université, mais il y a aussi de l’anxiété et de l’incertitude. S’ils ne partent peut-être pas avec une longueur d’avance, ces étudiants apprennent vite à se débrouiller seuls dans le monde des études postsecondaires.
Marianne Dépelteau – Francopresse
Les étudiants de première génération sont ceux dont les parents n’ont pas fait d’études postsecondaires.
Denis Mayer, ancien vice-recteur associé aux Affaires étudiantes à l’Université Laurentienne, à Sudbury en Ontario, a fait sa thèse de doctorat sur l’engagement, le rendement et la persévérance de ces étudiants de première génération par rapport aux autres.
L’engagement de l’étudiant semble être révélateur : « Si l’on voit qu’un étudiant est engagé, normalement la persévérance est plus élevée. »

La préparation aux études n’est pas moins importante, car « ceux dont les parents ont fait des études postsecondaires […] sont mieux capables de préparer leur enfant [sont plus aptes à] entreprendre ce genre d’études parce qu’ils ont une idée de ce qui se passe ».
Danielle Lorenz, originaire de Caledon East, près de Toronto, étudie maintenant au doctorat à l’Université de l’Alberta. Elle a été la première de sa famille immédiate à faire des études postsecondaires. Au début de son baccalauréat, elle avoue s’être sentie excitée et « un peu nerveuse. Mes parents ne pouvaient pas me guider […] J’étais livrée à moi-même […] Je ne savais pas où chercher de l’information ».
« J’avais des amis en première année dont les parents corrigeaient leurs dissertations, leur montraient comment étudier ou quels cours ils pouvaient suivre, ajoute-t-elle. Mes parents m’ont dit avec beaucoup d’amour bonne chance, il faut que tu te débrouilles toute seule. »

Il faut toutefois comprendre que les étudiants de première génération ne sont pas privés d’emblée de soutien à la rentrée. « Peut-être que les parents ne sont pas allés [au postsecondaire], mais les parents ou la famille les ont préparés suffisamment pour être assez confiants de faire cette première étape, s’inscrire et croire qu’ils veulent réussir et qu’ils sont capables », précise Denis Mayer.
Étudier pour résister
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Sudbury, Serge Miville, était un étudiant de première génération. Originaire de Smooth Rock Falls dans le Nord de l’Ontario, il a choisi d’aller étudier à l’Université d’Ottawa à cause de la situation économique de sa localité.

Il déplore que « le milieu universitaire ne soit pas structuré pour le milieu populaire ». Pour lui, les études universitaires ont été une façon de résister et de se battre pour sa communauté : « Quand tu viens du Nord de l’Ontario, tu constates qu’il y a énormément d’injustices économiques, et ce sont des facteurs qui mènent vers l’engagement, dans mon cas. »
Serge Miville avoue ne pas s’être beaucoup investi lors de sa première année à l’université, mais deux évènements ont changé le cours des choses pour lui : « C’est la fermeture de l’usine [de pâte commerciale de Tembec] qui a été un évènement traumatisant pour la communauté, pour la famille, pour moi-même. [Il y a aussi eu] le contact avec des professeurs, [notamment] avec un professeur franco-ontarien originaire de Sudbury, soit quelqu’un du Nord en qui je pouvais me reconnaitre. »
Il admet avoir trouvé du réconfort en voyant des gens comme lui. Il a trouvé de « l’empathie aussi, quelqu’un qui comprenait c’est quoi être Franco-Ontarien, minoritaire, avoir de la misère à écrire, de la misère à comprendre ce qu’on lisait… »
« Il y a plusieurs occasions qui essaient de nous dire t’appartiens pas ici, mais ensuite, tu les fais mentir par ton engagement et par ta réussite ».
Se fondre dans le décor
Christopher Gunther, professeur adjoint à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université Saint-Paul à Ottawa, remarque qu’« il est difficile d’identifier [les étudiants de première génération] au début ».

« Je commence à les identifier peut-être au milieu et vers la fin [de la session], dit-il, à cause de l’augmentation de leur anxiété ou peut-être de leur inquiétude, surtout la première année parce qu’il y a beaucoup d’incertitudes sur le déroulement du cours ou sur la façon dont les devoirs doivent être faits. »
En général, il les trouve plus incertains – notamment de la culture universitaire – plus anxieux et plus réservés que les autres étudiants. « Parfois, ils peuvent être prêts à faire un peu plus d’efforts que les autres élèves parce qu’ils ont l’impression d’être constamment à la traine ou de découvrir du nouveau, ce qui peut les pousser à travailler plus fort pour compenser ces différences. »
Comme le souligne Denis Mayer dans son étude, Christopher Gunther observe que plusieurs étudiants de première génération sont préoccupés par leurs finances. Ils ont de la pression afin d’éviter de devoir reprendre des cours.
« Les étudiants de première génération semblent réservés, mais plus curieux, trouve-t-il. Je pense qu’ils sont conscients de l’existence d’un certain type de culture et de système et qu’ils sont curieux de savoir comment l’apprivoiser, l’expérimenter et le faire d’une manière appropriée et respectueuse. »
Effet linguistique
À l’Université Laurentienne, Denis Mayer a remarqué que « les étudiants francophones [de première génération] sont minoritaires et normalement assez forts dans les études au secondaire avec une tendance à vouloir foncer. Ils sont motivés. »
Son étude a montré que la variable linguistique joue sur l’engagement des étudiants de première et deuxième génération. Ceux qui sont de langue française seraient notamment mieux préparés pour les cours et participeraient plus souvent aux discussions que leurs homologues anglophones.
Denis Mayer a aussi relevé que les étudiants de première génération inscrits dans des programmes de langue française obtenaient de meilleures moyennes pour les crédits accumulés que ceux inscrits dans des programmes de langue anglaise.
« Les francophones surtout étaient beaucoup plus courtois et je pense qu’ils travaillaient davantage, remarque le chercheur. La différence était que les étudiants francophones travaillaient davantage avec les professeurs des cours. »
Étudiants étrangers
De plus en plus, les étudiants de première génération qui s’inscrivent à l’Université Saint-Paul proviennent de l’étranger, une tendance qu’avait déjà remarquée Christopher Gunther à l’Université de la Saskatchewan lorsqu’il y enseignait. « Je peux constater qu’ils sont peut-être encore plus nerveux parce qu’il y a aussi des barrières sociales supplémentaires en plus, parfois, des barrières linguistiques. »
Selon Denis Mayer, « dans d’autres cultures, chez les immigrants, c’est très visible. On voit que des parents immigrants occupent des emplois moins bien vus, que les gens ne veulent pas faire. Tout le monde travaille pour que leurs enfants réussissent dans les études pour qu’ils aient un poste payant et avec un statut. »
Entre les avantages et les inconvénients
« En général, ma responsabilité est de leur montrer mon soutien, explique Christopher Gunther. Je pense qu’il faut les encourager et je suis sûr que c’est encore plus important pour les étudiants de première génération s’ils se sentent un peu à l’écart ou incertains, leur rappeler et leur montrer quelles sont les ressources de l’école. »
Il insiste sur l’importance de ne pas faire de suppositions et de garder en tête que tout le monde ne connait pas nécessairement le fonctionnement d’une université.
Aujourd’hui, Danielle Morenz reconnait que ce qu’elle a vécu a des avantages : « Le fait de devoir me débrouiller seule a rendu les études supérieures plus faciles. »
Parallèlement, le titre d’étudiant de première génération s’accompagne parfois d’un sentiment de culpabilité. « Depuis que j’ai obtenu un diplôme universitaire et que je travaille maintenant à mon doctorat, il y a une grande différence dans ma capacité à communiquer avec mes parents parce que nos expériences sont si différentes », confie Danielle Morenz.
« Je me sens un peu coupable de cela, se reproche-t-elle. Je ne veux pas qu’ils se sentent stupides ou malheureux de ne pas être allés à l’université, parce que ça n’a pas d’importance pour moi. »