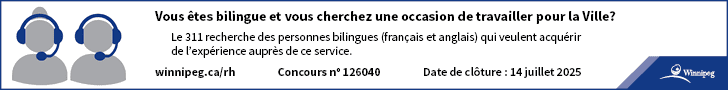FRANCOPRESSE – Aux quatre coins du pays, plusieurs organismes regroupant des travailleurs et travailleuses du sexe exigent l’abolition de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation qui criminalise certains aspects de leur travail. Ils souhaitent ainsi améliorer leurs conditions de vie et réduire les obstacles sociaux auxquels le secteur fait face.
Camille Langlade – Francopresse
L’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, qui réunit 25 groupes communautaires et organisations de partout au Canada, a lancé en octobre 2022 une contestation constitutionnelle de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE) devant la Cour supérieure de l’Ontario.
Les membres de l’Alliance exigent l’abrogation de différentes lois actuellement en vigueur qui violent, à leur avis, les droits des travailleurs et travailleuses du sexe et les empêchent d’exercer leurs activités en toute sécurité.
En 2014, le gouvernement fédéral a mis en place un ensemble de lois en vertu de la LPCPVE. Cette dernière criminalise l’achat de services sexuels, ainsi que le proxénétisme et toute publicité entourant la promotion de ces services.
« L’acte sexuel en soi n’est pas criminalisé, c’est tout ce qui l’entoure et les tierces parties impliquées qui le sont », résume Désiré Rioux, infirmier en santé mentale et titulaire de doctorat en sciences infirmières.

Avec ces nouvelles dispositions, le Canada a adopté ce qui s’appelle le modèle nordique ou scandinave de règlementation de la prostitution, déjà appliqué dans certains pays d’Europe. L’offre de services sexuels est en principe légale, mais pas le fait de payer pour ces mêmes services.
La loi concerne la prostitution de rue, mais aussi les espaces moins visibles comme les salons de massages érotiques, les clubs de danseurs et de danseuses ou encore les services sexuels en ligne.
« Les lois qui régissent actuellement le travail du sexe au Canada favorisent la stigmatisation et ouvrent la porte à la violence, alerte Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton. Elles empêchent les travailleuses d’avoir un consentement sécuritaire. Étant donné qu’elles ne peuvent pas interférer avec d’autres personnes, comme tenter d’arrêter une voiture en circulation par exemple, ou être dans certains lieux publics, on les empêche de mettre des mesures de sécurité pour se protéger. »
Aussi, les personnes qui se livrent à la prostitution ne peuvent pas faire de publicité, ce qui fait en sorte qu’elles n’ont pas la possibilité de filtrer à l’avance leur clientèle. Pour la chercheuse, ces lois traduisent une certaine hypocrisie. « La prostitution est légale, mais ce qui est criminalisé c’est en fait tous les moyens que les travailleuses ont pour faire leur travail. »

Une loi hypocrite?
Ces travailleurs et travailleuses n’ont accès à aucune protection, ni assurance-emploi, ni congé parental, rappelle Sandra Wesley, directrice générale de l’association Stella, l’amie de Maimie à Montréal, membre de l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe.
« Si une travailleuse du sexe travaille de chez elle et si elle reçoit un client, poursuit la directrice, elle commet un acte criminel. Son propriétaire peut l’évincer de son logement ou alors la menacer, augmenter le loyer de façon dramatique, exiger des services sexuels, etc. On se retrouve parfois dans une situation d’extorsion. »
Pour Désiré Rioux, infirmier en santé mentale et titulaire d’un doctorat en sciences infirmières, la loi pousse les personnes à prendre des risques. Lors de ses études à l’Université d’Ottawa, il a publié une thèse de recherche portant sur les risques en santé et en sécurité pour les danseurs nus dans les bars au Canada.
« Si jamais un travailleur du sexe fait face à un problème d’abus, verbal ou financier, il ne peut pas rapporter cela aux tenanciers du lieu où il travaille ou à quelqu’un d’autre. Il vit dans l’isolement », déplore-t-il.
Il explique que « le gain financier est priorisé au détriment des enjeux de santé et de sécurité, parce que les lois imposent des contraintes », ce qui empêche à ses yeux l’instauration d’un environnement de travail sain.
Désiré Rioux rappelle que dans les bars de danseurs notamment, les employés ne sont pas rémunérés à l’heure, mais plutôt à l’acte. Leur salaire dépendra ainsi du nombre de clients qu’ils voient. Difficile alors pour eux de dire non.
« Si le client arrive avec 100 dollars et veut du sexe oral, le danseur va vouloir sécuriser cette transaction pour pouvoir payer son épicerie, ses factures », explique-t-il.

Stigmatisation sociale
Pour l’Alliance, cette loi renforce la marginalisation sociale des travailleurs et travailleuses du sexe. Pire, la plupart des acteurs du milieu ont même intériorisé cette stigmatisation, affirme Aja Mason, directrice générale du Conseil yukonnais de la condition de la femme, une organisation qui soutient la contestation constitutionnelle.
« Si on leur demande s’ils sont des travailleurs [ou des travailleuses] du sexe, beaucoup de gens ne vont pas s’identifier à cette étiquette », est convaincue Aja Mason. À ses yeux, la loi invisibilise encore davantage des personnes déjà isolées dans la société.
« Si toutes les couches sociales sont concernées, les études montrent que les personnes autochtones, transgenres, non binaires, racisées ou immigrées sont souvent surreprésentées dans cette industrie-là », ajoute Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton.

Le travail du sexe en milieu rural
Le travail du sexe ne se limite pas aux grands pôles urbains, remarque Madeline Lamboley, professeure de criminologie à l’Université de Moncton. « En milieu plus rural, les femmes vont pratiquer une activité sexuelle en échange d’argent, de biens ou services », comme un paquet de cigarettes ou un trajet en voiture. « Ce sont des femmes qui sont souvent en manque d’argent et isolées géographiquement. »
Et la chercheuse d’ajouter : « C’est une pratique plus cachée, de bouche à oreille dans les petites communautés […] Tout le monde le sait et personne ne le dit. »
Entre légalité et moralité
Avec la décriminalisation des lois qui entourent leur profession, les travailleurs et travailleuses du sexe aspirent à de meilleures conditions de travail, indépendamment des questions morales ou des préjugés qui entourent souvent le milieu.
« Il faut regarder la réalité en face, les faits, et mettre de côté la moralité et les émotions, estime Sandra Wesley. Les gens veulent nous sauver […], mais on travaille parce qu’on a besoin de travailler, parce qu’on a des factures à payer. »
Elle appelle les personnes qui s’inquiètent de la sécurité des travailleurs et travailleuses du sexe à d’abord les écouter. «On demande à avoir accès aux mêmes choses que les autres.»
« Quand on parle du travail du sexe, on considère l’agentivité des femmes, c’est-à-dire le fait qu’elles sont capables de prendre leurs propres décisions. Mais qu’elles fassent ce choix-là consciemment ou qu’elles le fassent par absence de choix, elles ont, quoiqu’il en soit, le droit à une protection, ce qu’elles n’ont pas actuellement », constate Madeline Lamboley.
Précisément, pour Sandra Wesley, les lois actuelles mettent des bâtons dans les roues de celles qui voudraient sortir de la profession. « La stigmatisation, énorme, nous empêche de faire autre chose. Certaines vont vouloir faire des études et être infirmières, par exemple. Puis on va découvrir qu’elles étaient travailleuses du sexe et on va leur fermer la porte. Il y a une panique morale. »
Une première étape
La contestation constitutionnelle devant la Cour supérieure de l’Ontario ne constitue qu’une première étape dans le processus de décriminalisation. « Pour qu’une décision de la Cour puisse abroger complètement ces lois […], il faudrait que l’affaire aboutisse également devant la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada, ce qui pourrait prendre plusieurs années », rapporte l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe.
« C’est l’occasion de voir comment le pouvoir judiciaire va interpréter les limites de la constitution canadienne », note Aja Mason, car selon l’Alliance, la Loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées enfreint les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, comme la liberté d’association et le droit à l’égalité.