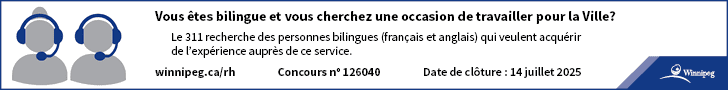Les oppositions d’idées perdurent quant à la manière de s’attaquer à la problématique des opioïdes. Qu’il s’agisse de l’Europe ou de l’Amérique du Nord, l’opinion publique est encore loin du consensus. Pourtant, alors que les morts par surdose ont atteint un niveau record l’an dernier au Manitoba, il apparaît que le statu quo ne fonctionne pas. Faut-il s’engager pleinement dans la réduction des méfaits?
Par Hugo BEAUCAMP
En octobre dernier se tenait le congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Pour l’occasion, une délégation de quelques étudiants et professeurs de l’Université de Saint-Boniface (USB) s’est rendue à Ottawa où avait lieu l’évènement.
Les représentants d’une trentaine de pays ont pu échanger sur les nouvelles pratiques, innovations et les recherches en sciences infirmières. Pour les étudiants de l’USB, ce fut l’occasion de s’imprégner davantage des défis et des enjeux de leur futur métier mais pas seulement. « C’était aussi l’occasion de présenter nos projets de santé communautaire aux personnes qui étaient sur place » explique René Piché, étudiant au baccalauréat en sciences infirmières de l’USB. Le jeune étudiant en a profité pour parler et faire parler de son projet de « réduction des méfaits en zone rurale dans les écoles secondaires. »
| Mais alors, qu’est que la réduction des méfaits?
« Contrairement à l’approche classique qui vise à réduire les comportements dits à risque, notre approche ne porte pas de jugement et intervient auprès des gens pour les accompagner dans leurs comportements et réduire les risques associés à la consommation de drogues. Mais aussi aux pratiques sexuelles.
« Comme nous partons du principe qu’on ne peut empêcher les gens de faire ce qu’ils veulent, l’objectif est alors de prévenir, par exemple, les grossesses imprévues, la transmission d’IST (infection sexuellement transmissible) et dans le cadre de la drogue, les surdoses. » Avec cette approche en tête, le futur infirmier a donc développé, en partenariat avec le Manitoba Harm Reduction Network (MHRN), un projet dont il parle avec beaucoup de ferveur : « Suite à des ana-lyses approfondies, nous avons déterminé que beaucoup d’élèves de secondaire ont de fausses idées à propos de la consommation de drogue et des rapports sexuels. Alors nous nous sommes dit qu’il fallait intervenir auprès des enseignants pour les préparer à éduquer les jeunes. »
Aujourd’hui, en dernière année de baccalauréat de sciences infirmières, ce travail de concert avec le MHRN touche à sa fin, mais cela ne signifie pas forcément la fin du projet. « Il n’y a pas vraiment de continuité, on remet à notre partenaire un plan très détaillé pour leur permettre de continuer à travailler dessus s’ils le souhaitent. » Impossible de savoir ce que la MHRN compte faire de ce projet concrètement, malgré nos multiples relances, aucune réponse ne nous a été donnée de leur part.
| “Le statu quo ne fonctionne pas”
Précisons qu’il ne s’agit pas d’encourager les gens à adopter des comportements dangereux. Cette volonté de développer une nouvelle approche à la problématique, elle provient d’un constat simple. « En 2021, selon l’Agence de santé publique Canada, tous les jours, 21 personnes en moyenne sont mortes de surdose. Le statu quo ne fonctionne pas. Cette approche de réduction des méfaits crée un rapproche-ment entre les consommateurs, le système médical et les travailleurs sociaux. Donc, s’ils sont prêts au changement, ils peuvent obtenir de l’aide plus facilement », explique René Piché. Ne rien faire pour stopper la consommation, mais l’encadrer pour s’assurer que ceux qui consomment restent en vie, c’est leur donner du temps. Du temps pour possiblement essayer de s’en sortir. Cela passe par l’éducation, ainsi que par la mise en place de structures comme les centres de consommation supervisée.
L’objectif à long terme de cette approche, aux antipodes de celle qui prévaut actuellement dans la majorité des pays du monde, c’est d’en arriver à décriminaliser la possession (en petite quantité) et la consommation de drogue. Un changement si radical qu’il pourrait faire peur, mais qui en réalité, n’aurait rien de bien révolutionnaire.
| Déstigmatiser
En veut pour preuve, les années 1920 et la prohibition, qui, si quoi que ce soit, n’ont fait qu’encourager la criminalité et la consommation illégale de produits manufacturés sans règlementation et par conséquent plus dangereux. Plus récemment, la légalisation du cannabis qui fait encore aujourd’hui l’objet de grands débats de l’autre côté de l’Atlantique. Pour David Alper, professeur à l’école de travail social à l’Université de Saint-Boniface, les détracteurs de cette notion de dépénalisation n’en ont simplement pas bien saisi les tenants et les aboutissants. « La décriminalisation, ce n’est pas approuver la consommation mais c’est reconnaître que les gens vont consommer qu’on le veuille ou non. Il faut traiter la question comme relevant de la santé. Comme une affaire sociale et pas comme une affaire criminelle. »
Pour lui, le parti pris actuel à l’égard de la drogue fait plus de mal que de bien : « Il faut déstigmatiser ces populations-là. Elles ont justement tendance à éviter de chercher de l’aide ou d’avoir recours aux services sociaux et de santé précisément car ils se sentent rejetés et jugés. » Le professeur, ayant travaillé pendant plus de quatre ans aux urgences de l’Hôpital Saint- Boniface relate son expérience : « J’ai vu comment certains professionnels interagissaient avec des patients soupçonnés de consommer de la drogue. Il y avait du mépris. Par conséquent ces patients-là hésitent même à consulter et là ça devient dangereux. »
Bien sûr, les expériences personnelles des uns ne sont jamais représentatives d’une réalité globale, mais la question mérite d’être posée : faut-il faire changer les mentalités?
| Faut-il faire changer les mentalités?
Ce n’est pas chose facile, d’autant plus que les sites de consommation supervisée posent un problème sur le plan déontologique. Certains professionnels de santé pourraient, à juste titre, s’irriter d’aider des patients à se droguer et on ne peut ignorer les craintes de certains de voir une banalisation de la consommation rendre caducs les efforts de prévention chez les jeunes. D’un autre côté, à l’heure où le fentanyl inonde le marché noir de la drogue, une régulation gouvernementale de ce dernier permettrait sans doute de sauver des vies. Pratiquement indétectables, deux milligrammes de fentanyl pur, suffisent à tuer un adulte. Le produit est d’ailleurs l’un des principaux responsables des taux élevés de surdoses actuels.
Quoi qu’il en soit, David Alper n’en démord pas : « Le gouvernement fédéral devrait se saisir de la question, on a vu des pays décriminaliser en Europe et la consommation reste moindre qu’en Amérique du Nord. » Un constat que corrobore le rapport mondial sur les drogues publié en 2020 par l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Tournons-nous alors vers l’Europe, et le Portugal en particulier. En 2001, alors que les politiques de répression n’arrivent à rien, le pays fait le choix de décriminaliser les drogues et d’investir dans des structures de consommation supervisée, 20 ans plus tard, quelles conclusions peut-on en tirer?

| Résultats probants
Ce qui ressort de l’étude menée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) est assez simple : dans la première décennie suivant la mise en place de la réforme, les résultats ont été probants. Baisse des dommages liés à l’usage de drogues, baisse de la mortalité par surdose, réduction des nouveaux cas de VIH mais aussi des morts associées au VIH, baisse de la population pénale, baisse des niveaux d’usage de drogues illicites (à l’exception du cannabis) et baisse des coûts sociaux liés aux drogues.
En revanche, ces dix dernières années, la tendance s’est inversée. Mais là encore, il faut tenir compte du contexte politique, social, économique et culturel du pays. À noter aussi la crise économique de 2008. In fine, la situation au Portugal en 2019 reste bien plus favorable qu’elle ne l’était en 2000. Le rapport de l’OFDT souligne d’ailleurs qu’en Europe (1), le pays se démarque par ses faibles taux de mortalité par surdose et d’usage de drogues en général, notamment parmi les plus jeunes. Un succès en demi-teinte, mais un succès quand même.
Sans aller jusqu’à la dépénalisation, l’adoption d’une politique de réduction des méfaits semble donc assez raisonnable. Au Canada, le site du gouvernement recense 39 sites de consommation supervisée répartis entre la Saskatchewan, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Pas un seul au Manitoba. À noter tout de même, la création du centre de prévention de surdose mobile créé par l’organisme Sunshine House à la fin du mois d’octobre. Mais il ne s’agit pas exactement d’un centre supervisé puisqu’aucun professionnel de santé n’opère à bord. En tout cas, dans le but de démocratiser ces pratiques de réduction des méfaits dans la province, plusieurs organismes s’adonnent à de véritables tours de force, comme l’explique David Alper. « L’un de nos stagiaires a travaillé sur les sites de consommation éphémères lancé par la Manitoba Harm Reduction Network. Une activité illégale mais qui avait pour but de mettre la pression sur le gouvernement provincial afin qu’il légifère sur le sujet. »
| Investissements
Seulement voilà la Province semble bien campée sur ses positions. Dans un communiqué publié au mois de novembre, la ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté, Sarah Guillemard annonçait que le gouvernement manitobain oeuvrait à poursuivre ses investissements « dans le traitement et le rétablissement à long terme des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et de toxicomanie », puis plus loin dans le communiqué, « notre priorité est de rendre le traitement disponible aux Manitobains lorsque ceux-ci sont prêts pour le rétablissement. » Cette démarche implique donc que le consommateur ait déjà pris la décision de mettre un terme à sa dépendance.
Quant à la mise en place de centre de consommation supervisée, l’option n’est pour le moment pas envisagée par la ministre qui affirme. « Les Provinces et Territoires qui ont officialisé les sites de consommation supervisée ne connaissent pas une réduction du taux de consommation de drogues ou du nombre de surdoses mortelles. Si nous voulons favoriser le rétablissement des toxicomanes, il est beaucoup plus avantageux d’investir dans les centres de traitement et d’en fournir l’accès au lieu d’utiliser des sites de consommation supervisée et de les laisser continuer à consommer. » Des propos que la revue scientifique réputée The Lancet vient démentir. L’article publié en octobre 2022 stipule que, suite à l’ouverture du centre de consommation supervisée Insite à Vancouver, les morts par overdose ont diminué de 35 % dans un périmètre de 500 m autour de la structure contre 9 % dans le reste de la ville (2). De plus, le rapport fait mention d’études complémentaires prouvant qu’aucune augmentation ou réduction des comportements criminels ne peut être associée à l’ouverture d’un centre.
| Améliorer les services
Malgré ces déclarations, depuis 2019, le Manitoba a investi plus de 62 millions $ dans de multiples initiatives pour améliorer les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. « Plus de 2,4 millions de dollars sont attribués annuellement à des initiatives de réduction des méfaits. » Cela comprend la distribution de seringues et autres fournitures, l’accès à des médicaments essentiels comme la naloxone (qui renverse les effets d’une surdose) et quelques projets pilotes comme le recours au narcan (lui aussi contre les effets d’une surdose). Finalement 90 000 $ seront aussi attribués au Manitoba Harm Reduction Network pour servir à la sensibilisation et à des programmes pédagogiques, la distribution de fournitures.
(2) The North American opioide crisis : how effective are supervised consumption sites?