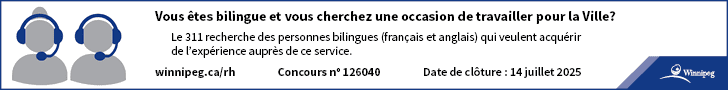Chantallya Louis
Mary T. Moreau parle de son histoire, son parcours et son engagement dans la francophonie canadienne.
Francopresse : Vous venez d’être assermentée en tant que juge à la Cour suprême du Canada. Vous êtes une fière Franco-Albertaine qui exerce le droit depuis près de 30 ans, mais qui est la femme derrière la juge Moreau?
Juge Mary T. Moreau : Je suis native de l’Alberta, sixième de huit enfants, un père franco-albertain avec un grand-père qui, lui, a déménagé du Québec aux Prairies et une mère anglophone avec du sang écossais et irlandais. Alors, je suis un produit d’une famille exogame. Les deux langues étaient utilisées à la maison durant ma jeunesse.
Je suis allée aux écoles bilingues, ce qui voulait dire 50 % en français, soit la limite prescrite par la législation provinciale à cette époque.
Par la suite, je me suis inscrite à une faculté francophone, le campus Saint-Jean, de l’Université de l’Alberta, où j’ai suivi des cours en arts ainsi qu’en sciences, parce que je n’avais pas encore décidé ce que je voulais faire comme carrière.
Après quelques années, j’ai poursuivi mes études à l’École de droit de l’Université de l’Alberta.
J’ai été nommée juge à l’âge de 38 ans, alors que les femmes composaient seulement un quart environ de la Cour. À l’époque, des dispositions en vigueur du Code criminel exigeaient d’avoir des juges bilingues pour présider des procès en français. C’est ce qui, je pense, a été valorisé dans ma nomination.
Vingt-trois ans plus tard, j’ai été nommée juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, qui est maintenant la Cour du Banc du Roi.
Vous avez un intérêt marqué pour le droit criminel et constitutionnel, mais vous avez aussi cofondé l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA). On peut comprendre que la francophonie a une place importante pour vous?
Bien entendu, c’est mon histoire personnelle, la langue et la culture, qui fait partie de moi.
Quand j’ai commencé à pratiquer à Edmonton, j’avais une clientèle mixte francophone et anglophone.
J’ai fait beaucoup de droit criminel en tant qu’avocate de la défense et c’est là où j’ai rencontré un client qui a voulu subir son procès criminel en français pour trafic de cocaïne.
C’est le début d’un long voyage, un parcours de quatre niveaux de tribunaux jusqu’à la Cour suprême pour établir le droit de cet accusé de subir son procès en français. À l’époque, les dispositions du Code criminel qui permettaient le procès dans l’une ou l’autre ou les deux langues n’avaient pas été proclamées en vigueur en Alberta.
C’était vraiment le lancement d’une carrière en droit constitutionnel ainsi qu’en droit criminel et en litige civil et familial.
Dans ma carrière d’avocate, j’ai aussi participé à l’affaire Mahé sur l’interprétation des droits de l’article 23 de la Charte des droits et libertés qui s’est rendue en Cour suprême. J’étais un des conseillers juridiques pour les appelants.
Quand j’étais juge de procès, j’ai présidé plusieurs causes et procès en français devant jury, y compris des affaires de droit criminel, et j’ai aussi présidé des procès en français, surtout comme juge suppléant, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour suprême du Yukon.
Alors, comme juge en chef, ça m’intéressait de créer plus d’espace pour l’accès à la justice dans les deux langues officielles, vu les dispositions du Code criminel sur l’offre de services en français.
Sous mon administration, on a développé une politique pour les services en français qui incluait les conseils, les avis enregistrés aux accusés à leur première comparution devant notre cour. Ils avaient la possibilité d’avoir un procès en français ou en anglais ou bilingue.
Ce sont des étapes comme ça qui, pour moi, suivaient la rigueur des dispositions du Code criminel.
« Je pense qu’à la Cour suprême, les membres de la Cour ont différentes origines ethniques, géographiques, culturelles, et je pense que c’est une bonne chose que la Cour contienne cette diversité pour que les gens puissent se reconnaitre dans sa composition. »
Juge Mary Moreau
Votre nomination a une valeur historique, car pour la première fois à la Cour suprême du Canada, il y a plus de femmes juges que d’hommes. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Pour moi, ça signifie une évolution importante. Les femmes constituaient un quart de ma classe en droit à l’Université de l’Alberta. Maintenant, les femmes représentent facilement la moitié des étudiants dans les classes de droit.
C’est une évolution à ce niveau-là. En matière du choix de carrière que j’ai fait comme avocate, les femmes étaient plutôt rares en droit criminel. On les voyait moins au niveau de la défense.
J’ai vu dans ma carrière, et surtout durant ma carrière de juge, que ça aussi, ça a évolué. Maintenant les femmes participent activement à la défense criminelle. Et comme juge, quand j’ai accepté une nomination à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, en 1994, on était environ un quart de femmes.
Maintenant, on est très très proches de 50 % des femmes à la Cour du Banc du Roi. C’est donc une autre évolution.
Je suis très très contente d’être dans un contexte où les femmes occupent maintenant une place majoritaire à la Cour, ce qui veut dire que l’évolution continue. J’espère qu’il y aura un moment où ça ne sera plus remarquable.
Maintenant que vous êtes à la Cour suprême du Canada, quelle sera votre priorité?
Comme j’ai dit au Comité parlementaire, c’est de rendre justice, d’écouter, de réfléchir dans un contexte qui est nouveau pour moi. J’ai beaucoup à apprendre, mais de rendre justice, je pense que c’est l’aspect le plus important pour que le public soit confiant dans le rôle des tribunaux et de la Cour suprême dans le système de justice.
Avec mon travail à l’international, la primauté du droit est quelque chose à nourrir tout le temps. Il ne faut pas le prendre comme acquis, même dans une démocratie très développée.