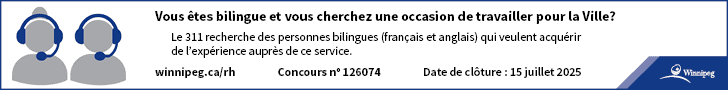Retour sur les jalons historiques de la plus haute instance juridique au Canada.
Il y a presque 150 ans, le 8 avril 1875, une loi fédérale a permis la création de la Cour suprême du Canada (CSC), après plusieurs tentatives échouées.
Le juge en chef de la CSC depuis 2017, Richard Wagner explique : « L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, en 1867, créait la possibilité pour le Parlement fédéral de mettre sur pied une cour d’appel générale pour le Canada. Il y a eu des premières tentatives en 1868 et 1870, mais c’est vraiment en 1875 que la Cour suprême du Canada a finalement vu le jour. »
Ce qu’on a appelé Cour suprême du Canada n’était toutefois pas la Cour de dernier ressort pour les Canadiens et Canadiennes.
« Jusqu’en 1949, il y avait au-dessus de la CSC le Comité judiciaire du conseil privé, à Londres, qui pouvait entendre des appels venant de toutes les cours supérieures du Commonwealth, incluant la CSC. »
Ce n’est qu’en 1949, suite à la Seconde Guerre mondiale, que le Canada est devenu souverain au niveau de ses instances judiciaires, pour que les citoyens canadiens ne dépendent plus d’une autorité étrangère. La CSC est alors vraiment devenue la cour de dernière instance du Canada.
La Loi du 8 avril 1875 prévoyait déjà une représentation du Canada anglophone et du Québec, et donc par conséquent des francophones et des anglophones, mais aussi de la common law et du droit civil. En effet, « la CSC a la particularité d’être la seule cour suprême bilingue et bi-juridique au monde », rappelle Richard Wagner.
Bi-juridique et bilingue
Il précise : « À l’origine, il y avait six juges prévus dans la Loi : deux du Québec, deux de l’Ontario et deux des provinces maritimes. C’était le résultat d’un compromis. À l’époque, les résidents du Bas-Canada étaient soucieux de garder leur régime de droit civil. Donc pour accepter une CSC qui couvrirait l’entièreté du pays, leur condition était qu’il y ait au moins deux juges de formation civiliste, donc du Québec, sur le banc. »
Le nombre de juges a été augmenté à sept en 1927, puis neuf en 1949, son effectif actuel : trois du Québec, trois de l’Ontario, deux des provinces de l’Ouest ou des territoires du Nord, et un.e des provinces de l’Atlantique.
Richard Wagner précise toutefois que la présence de juges du Québec « n’était pas une garantie constitutionnelle jusqu’au Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, en 2014. Le Parlement fédéral pouvait amender la Loi sur la Cour suprême et modifier le nombre de juges provenant de n’importe quelle province.
« Avec cet arrêt clé dans son histoire, la CSC a décidé de constitutionnaliser la Cour suprême, de telle sorte qu’elle ne puisse pas être modifiée par une simple loi votée à la majorité du Parlement fédéral. Désormais, ça prendrait un amendement constitutionnel, soit l’appui d’au moins sept provinces sur dix et 50 % de la population canadienne. »
Un autre moment historique fut la Loi constitutionnelle de 1982 et la Charte canadienne des droits et libertés. « C’est à ce moment-là que la CSC a été identifiée comme gardienne de la Constitution, un rôle qu’elle n’avait pas aussi clairement avant. C’était à elle d’interpréter les droits et libertés consignés dans la Charte. La CSC a alors commencé à vraiment changer la face du Canada par ses décisions. »
Et le français?
Bien qu’il y ait souvent eu des francophones sur le banc, ce n’était pas une garantie dans les débuts de la CSC. Mais la Cour, comme la société, a évolué. « La Loi sur les langues officielles, en 1969, a fait en sorte que les tribunaux fédéraux traduisent leurs jugements dans les deux langues officielles. Depuis, la CSC n’a jamais failli à son devoir. Toutes nos décisions sont rendues dans les deux langues, et ce sont deux versions officielles. Tous les juges de la Cour, anglophones et francophones, bilingues ou avec l’aide de jurilinguistes ou d’auxiliaires juridiques, doivent vérifier le libellé des deux versions. »
Richard Wagner précise qu’un amendement en 2023 à la Loi sur les langues officielles exige désormais que tous les juges de la CSC soient bilingues fonctionnels. « C’est donc maintenant un prérequis pour accéder à la CSC, mais la grande majorité des juges étaient déjà bilingues de façon fonctionnelle quand je suis devenu juge en chef. »
Modèle de diversité
Par ailleurs, la CSC a connu un autre moment charnière en 1982, avec l’arrivée sur son banc de la première femme, l’honorable Bertha Wilson, de l’Ontario.
Le juge en chef Wagner souligne d’ailleurs que depuis la nomination de l’honorable Mary T. Moreau, de l’Alberta, en novembre 2023, pour la première fois de son histoire, le banc compte plus de femmes (cinq) que d’hommes (quatre).
« La CSC a été précurseure en matière de diversité sur le banc, affirme-t-il. Elle a souvent montré la voie à d’autres juridictions. Bien avant la Loi sur les langues officielles, par exemple, on traitait déjà en anglais et en français puisqu’on couvrait le Québec. Les juges ont toujours écrit dans leur langue. »
En outre, un premier juge racisé, l’honorable Mahmud Jamal, Ontarien originaire du Kenya, a été nommé en 2021. Une première juge autochtone, la Franco-Ontarienne membre abénakise de la Première Nation d’Odanak, Michelle O’Bonsawin, a également rejoint le banc en 2022.
Se faire connaître
Un autre jalon historique a été franchi en septembre 2019 : c’était la première fois que la CSC sortait d’Ottawa pour plaider dans une autre province, et c’est Winnipeg qui l’a accueillie. (1)
Richard Wagner en explique les raisons : « Quand je suis devenu juge en chef en décembre 2017, j’ai vu que les Canadien.ne.s n’avaient pas une bonne connaissance des travaux de la Cour, de la Cour elle-même et de ses juges, parce que souvent, les gens se fient sur les médias pour savoir. Mais les médias traditionnels ont beaucoup rétréci. Donc je voulais mettre plus d’énergie et de temps à faire connaître nos travaux, en allant notamment siéger ailleurs. C’était assez révolutionnaire après avoir seulement siégé à Ottawa depuis 144 ans! »
La décision a donc été prise de se rendre à Winnipeg « car c’était en plein milieu du pays et qu’il y avait de belles communautés francophone et autochtone. Et cela a été un grand succès ».
Pour preuve : la longue file d’attente sur le trottoir devant le palais de justice pour pouvoir assister à l’audience. « Il a fallu ouvrir une salle de débordement. Pour moi, ça démontrait bien un besoin de savoir, de connaître », analyse Richard Wagner.
L’expérience a été renouvelée en 2022 à Québec, avec autant de succès, et le juge en chef affirme que la Cour continuera de sortir régulièrement de la capitale canadienne.
(1) Voir notre dossier spécial dans La Liberté du 2 au 8 octobre 2019.