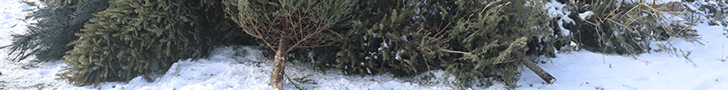Par Laurent GIMENEZ.
Dans le récit de son voyage dans la région des Grands Lacs au début des années 1830, l’écrivain français Alexis de Tocqueville raconte sa stupéfaction de rencontrer un jour, au moment d’embarquer dans un canot, un guide autochtone s’adressant à lui en français. « L’homme qui était accroupi au fond de cette fragile embarcation portait le costume et avait toute l’apparence d’un Indien, écrit Tocqueville. Comme je me préparais moi-même à y monter, le prétendu Indien s’avança vers moi, me plaça deux doigts sur l’épaule et me dit avec un accent normand qui me fit tressaillir : “Ah! vous venez de la vieille France!… Attendez, n’allez pas trop vitement; y en a des fois ici qui s’y noient.” Mon cheval m’aurait adressé la parole que je n’aurais pas, je crois, été plus surpris. »
S’il avait été mieux informé, Tocqueville ne se serait pas étonné de rencontrer dans ce coin reculé de l’Amérique un guide métis parlant la langue de Molière. Les Métis étaient à cette époque des acteurs clés du commerce des fourrures. Ils excellaient dans les fonctions de guide et d’interprète grâce à leur connaissance intime du milieu physique et à leur maîtrise de plusieurs langues, telles que le français (souvent leur langue première), le cri, l’ojibwé, le dakota, l’anglais ou le déné.
Le guide rencontré par Tocqueville parlait peut-être aussi le michif, la langue du peuple métis, combinant des éléments de français et de plusieurs langues algonquiennes, en particulier le cri. Mais quel michif exactement? La question se pose, puisqu’il existe en réalité plusieurs langues michifs très différentes les unes des autres. Selon les linguistes, seul le michif du sud peut être considéré comme une langue à part entière. C’est une langue mixte basée sur une combinaison unique et complexe de noms français et de verbes cris (voir le dictionnaire anglais-michif du Gabriel Dumont Institute à cette adresse : www.metismuseum.ca/michif_dictionary.php).
Les francophones du Manitoba sont plus familiers d’une autre variété de michif : le michif français. Un lecteur de La Liberté, Gerald Dufault, en a mentionné quelques caractéristiques dans une lettre publiée dans l’édition du 4 au 10 juin 2025. Sur le plan strictement linguistique, le michif fransay est considéré comme un dialecte du français, c’est-à-dire une variété régionale de cette langue. Ses origines remontent probablement aux premiers temps de la traite des fourrures (17e siècle). On pense que la majorité des locuteurs actuels sont établis à Saint-Laurent (Manitoba) et dans ses environs. C’est donc une langue endogène du Canada.
Comme le souligne Gerald Dufault dans sa lettre, le michif français possède quelques avantages par rapport au français en usage dans tout le Canada et à l’échelle internationale. Les mots s’écrivent comme ils se prononcent (« marto », « franbwayz », « saynchur fleshi ») et il n’y a pas d’accents écrits. Les liaisons phoniques font partie intégrante des mots : par exemple, « les arbres » s’écrit « li zabr ». L’influence des langues algonquiennes (en particulier le cri des prairies et l’ojibwé) se traduit, notamment, par une intonation mélodieuse et par l’absence des pronoms personnels genrés « elle » et « il »; on emploie à la place une formulation inclusive introduite par « y » ou « lizot » (pluriel). Ainsi, « y la vnu » signifie indistinctement « elle est venue » ou « il est venu ».
Tout francophone qui en fait l’effort peut arriver à comprendre le michif français. On peut s’y essayer en tentant de trouver le sens des phrases ci-dessous. Elles sont tirées du remarquable petit livre-dictionnaire intitulé Michif French as spoken by most Michif people of St. Laurent (en vente en ligne et en magasin chez McNally Robinson).
1. Kosay t’emraw saw fayr?
2. Kan ti jewn, ti krway kosay ta mitres ki dji.
3. Ja tolten emi sti bel lawng.
1. Qu’aimerais-tu faire? 2. Quand on est jeune, on croit ce que nous dit la maîtresse. 3. J’ai toujours aimé cette belle langue.