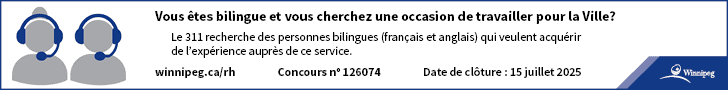DOSSIER – La période de crises scolaires se désamorce à partir de la fin des années 1920. Elle force cependant un constat : la Constitution de 1867 a failli à la tâche de protéger la langue française dans les écoles des communautés en situation minoritaire. Il fallait corriger le tir.
Andréanne Joly – Projet spécial
En 1967, le ministre de l’Éducation du Manitoba déclare : « Il est très convenable en cette année du centenaire de la Confédération que le français […] soit réintégré comme langue d’enseignement dans nos écoles publiques. » La nouvelle fait couler beaucoup d’encre. La Liberté et le Patriote et Le Devoir y consacrent des éditoriaux. Le Droit présente une série de six articles sur l’éducation en situation minoritaire, dont trois sur le Manitoba.
Des États généraux du Canada français ont lieu ainsi qu’une Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme qui donnera une loi sur le multiculturalisme et une Loi sur les langues officielles. Celle-ci avivera le bilinguisme dans l’appareil fédéral et susciter une nouvelle fierté nationale.
Pourtant, la question des écoles secondaires de langue française déclenche d’autres crises, en Ontario. Des élèves font la grève en 1971 à Sturgeon Falls, en 1973 à Cornwall et en 1979 à Penatanguishene pour réclamer des écoles homogènes, les écoles de langue française étant souvent logées dans des écoles dites bilingues.
+++
La crise de Sturgeon Falls
En 1971, le conseil scolaire de Sturgeon Falls, en Ontario, refuse d’établir une école secondaire de langue française, préférant conserver l’école bilingue. La communauté fait la grève et occupe l’école pendant trois jours.
Pour faire circuler l’information entre militants, un hebdomadaire est créé : «La Cause». Déjà, un hebdomadaire local bilingue existe depuis 1968 : La-The Tribune. Il couvre la question, épineuse au sein de la collectivité.
Quatre-vingt-dix kilomètres plus loin, à Sudbury, Le Voyageur couvre d’abord la grève sur place, précise l’actuel directeur de l’information, Julien Cayouette. Ensuite, la couverture se fait à distance. « Les articles observaient principalement les interventions de l’organisme provincial de représentation des francophones et du gouvernement. » Malgré la distance, « la prise de position du journal était flagrante, même hors de la page éditoriale », remarque Julien Cayouette.
En décembre 1971, le conseil scolaire fonde l’école Franco-Cité tout en maintenant l’école mixte, Northern.
+++
Des garanties
Le gouvernement fédéral répond à ces crises par des garanties constitutionnelles. En 1982, il enchâsse les droits civils, politiques et linguistiques des minorités dans la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 23 de cette Charte offre aux francophones en situation minoritaire la possibilité de faire leurs études primaires et secondaires dans des écoles de langue française là où le nombre d’élèves potentiels est suffisant.
Il faudra cependant recourir aux tribunaux «pour contraindre les gouvernements provinciaux récalcitrants à créer des réseaux d’écoles primaires et secondaires» et octroyer des droits explicites à la gestion scolaire.
++
Selon la journaliste et professeure de communication Manon Raîche, le nombre de journaux de langue française double de 1975 à 1990.
++
Des procès
Chaque dossier soumis à un tribunal est suivi de près par les provinces et territoires et, bien entendu, les médias de langue française des quatre coins du Canada. Ces jugements pourraient faire jurisprudence.
La Cour suprême du Canada intervient à quelques reprises. Ces causes précipitent l’apparition de commissions scolaires de langue française partout au pays : en 1993 au Manitoba, en 1994 en Alberta, en 1995 en Saskatchewan, en 1996 à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, en 1997 en Colombie-Britannique, en 1998 en Ontario…
Mahé c. Alberta, 1990
Au début des années 1980, le Roman Catholic Separate School Board District No. 7 d’Edmonton met sur pied un programme en français dans certaines écoles. Le personnel est francophone et l’administration se fait en français à l’échelon local, mais la gestion est assurée par un conseil scolaire de langue anglaise.
Pour plusieurs parents, c’est bien, pour d’autres, c’est insuffisant.
En 1985, Jean‑Claude Mahé, Angeline Martel, Paul Dubé et d’autres parents qui luttent depuis quelques années pour obtenir la gestion complète de leur école portent leur cause devant les tribunaux. Selon eux, le nombre d’élèves potentiels justifie amplement la demande.
Tour à tour, la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel de l’Alberta reconnaissent une partie des arguments présentés par les parents, mais rejettent la demande de gestion d’une école de langue française.
Le dossier est envoyé en Cour suprême en 1989.
En vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ce tribunal accorde aux parents le droit de gestion de leurs écoles, ce qui prévoit le droit de représentation, l’affectation adéquate de fonds, l’établissement de programmes scolaires et la conclusion d’accords pour les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique[1], lorsque le nombre le justifie.
Pour reprendre le professeur de droit Pierre Foucher, le jugement Mahé fait entrer le principe de la pleine mise en œuvre provinciale des droits linguistiques dans la jurisprudence. Pour l’un des plaignants, Paul Dubé, aussi universitaire, ce n’est rien de moins qu’une réécriture de l’histoire.
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000
En mars 1990, la Cour suprême du Canada confirme que la communauté de la minorité linguistique a droit de gestion et de contrôle de ses écoles «lorsque le nombre le justifie».
À l’Île-du-Prince-Édouard, les enfants de Summerside doivent faire près d’une heure d’autobus pour se rendre à l’école. Deux mères, Noëlla Arsenault-Cameron et Madeleine Costa-Petitpas, estiment qu’ils sont en nombre suffisant pour justifier la construction d’une école de langue française à Summerside. Le ministre de l’Éducation refuse.
L’affaire est portée devant les tribunaux, jusqu’en Cour suprême, qui donne raison aux parents et rappelle le caractère réparateur de l’article 23 de la Charte des droits et libertés. Non seulement « l’école est l’institution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle », décrète le tribunal, mais elle est aussi un outil de développement des communautés.
L’arrêt Arsenault-Cameron de 2000 stipule qu’il incombe au conseil scolaire de langue française, et non pas à la province par l’entremise de son ministère de l’Éducation, de déterminer où offrir les programmes éducatifs.
Le jugement Doucet-Boudreau de 2003 rappellera aux provinces et territoires leur devoir de respecter leurs obligations rapidement en matière d’éducation dans la langue de la minorité.
Dans cette affaire, des parents de la Nouvelle-Écosse réclamaient des écoles secondaires homogènes dans cinq districts scolaires depuis le milieu des années 1990. Ils avaient signé des pétitions, envoyé des lettres, produit des analyses. Les dossiers trainaient, mais la Cour suprême finit par trancher en leur faveur en indiquant que la Charte ne devrait pas être interprétée au sens étroit et légaliste. Le professeur Paul T. Clarke de l’Université de Regina pense plutôt qu’elle a même un objectif généreux et expansif.
D’autres causes
Les enjeux évoluent au fil de la jurisprudence. Aujourd’hui, les litiges portent sur la révision des formules de financement, la modernisation du parc immobilier et l’actualisation du concept d’ayant droit. « Rien de cela ne serait arrivé sans l’article 23 », note Pierre Foucher.
[1] Mahe c. Alberta, [1990] 1 RCS 342.